Miguel Decleire — 13:13
Je peux bien le révéler maintenant : je ne voulais pas vous dire que nous pensions afficher : « Faites-nous confiance », et le faire disparaitre, ou plutôt, le laisser disparaitre. L’idée était de la faire en beurre, ou plutôt en margarine (moins chère), et que sous la lumière des projecteurs, les lettres fondent. Mais ça n’a pas marché, ça ne fondait pas, à moins de les mettre à 30 cm de la source lumineuse – ce qui aurait rendu le dispositif trop volontariste. La déclinaison de cette idée a mené au dispositif que nous avons présenté vendredi.
Pour moi, c’était la manière la plus adéquate de rendre compte du double paradoxe face auquel le sujet nous plaçait : la question portait sur l’aveuglement des dirigeants ; mais également sur le nôtre, dans la mesure où nous portons une (relative, certes) responsabilité par rapport à nos dirigeants. Comment traiter ce thème ? Soit nous nous placions en-dehors de la question : nous mettions en scène l’aveuglement (feint ou réel) des dirigeants, nous le stigmatisions. Mais raisonnablement, en 5 jours, nous n’aurions pu étaler qu’un ramassis de lieux communs. Sans compter que nous nous serions par là-même placé dans la position même évoquée par Kenneth Bertrams : celle de gens dont la parole fait loi, vaut fait. Et qu’en définitive nous n’aurions fait que morigéner le public sur son propre aveuglement – ce qu’il sait déjà – tout en nous en dégageant, ce qui nous aurait mis dans la situation inconfortable d’être nous-mêmes aveuglés sur notre propre aveuglement. Cette piste était un cul-de-sac.
L’autre piste nous conduisait à aborder le sujet du point de vue réel où nous sommes, c’est-à-dire des aveuglés, au même titre que les spectateurs, sachant les mêmes choses qu’eux, ignorant les mêmes. Mais comment parler de son propre aveuglement ? Pour les sages chinois, c’est en cela que consiste la sagesse ultime, savoir ce qu’on ne sait pas. Que faisons-nous de notre ignorance ? Nous savons que nous ignorons suffisamment de choses pour déléguer les prises de décision à des gens dont nous supposons qu’ils en savent suffisamment pour trouver des solutions à l’avantage de tous, et donc au nôtre. Nous leur déléguons notre suffrage, et nous mesurons la confiance que nous leur accordons proportionnellement à ce que nous savons, ce que nous savons que nous ignorons, ce que nous estimons qu’ils comprennent mieux que nous, ce qu’ils sont capables de mettre en œuvre. Cette confiance, bien souvent, est déçue. Nous avons été les dupes de notre ignorance, nous nous sommes aveuglés sur leurs possibilités de changement réel. Pourtant, nous faisons confiance au suivant qui se présente, et en qui nous investissons la part de celle que nous avons retirée au précédent. Comme si cette confiance était une sorte de capital qu’il fallait à tout prix investir en dehors de nous, déléguer, dont il fallait nous défaire. Même si c’est pour protester, nous continuons à accorder la confiance au système qui nous demande de l’accorder au moins à quelqu’un.
Pour parler de la confiance et de l’aveuglement, pourquoi ne pas partir de celle que vous nous faites, quand vous venez à la représentation ? Une confiance qui va de soi, basique, qu’au moins « quelque chose » va arriver. L’utiliser comme métaphore résolvait le paradoxe de la double entrée dans le sujet. Et introduisait un peu d’humour : un peu éculé, peut-être, oui, le comique de répétition est le plus basique. Hyper-bergsonien dans le sens où c’est du mécanique plaqué sur du vivant – en l’occurrence, le spectateur. On peut comprendre la réticence que tout un chacun a de se voir obligé de participer au spectacle, à son insu. Mais cette fois-ci, c’était vraiment le sujet. C’était pour votre bien...
Stéphane Olivier — 00:35
Je réitère ma posture de vendredi dernier. J’écris à chaud en rentrant. Avec le recul minimum, a Bernard et Miguel de prendre de la distance. Ce soir je pense qu’on s’est frotté à un bord de notre théâtre, la proposition était minimale (2 phrases de 3 mots, du noir une musique qui se comporte comme un acouphène). Une proposition polémique; certains spectateurs était vraiment de mauvaise humeur d’autre pas du tout. Encore une fois on à tordu la syntaxe du contrat tacite de la représentation théâtrale pour essaye de reformuler l’interrogation implicite contenue dans notre sujet «L’histoire, le bon sens et la connaissance nous invitent a traiter avec circonspection des puissants, pourquoi alors nous aveugle-t-elle?».
Le contrat tacite/social que nous avons rompu en présentant une représentation sans spectacle est du même ordre que celui que brise l’homme politique qui ne tient pas ces promesses. Il s’agit bien d’une représentation (Action de rendre quelque chose présent à quelqu’un en montrant, en faisant savoir (mais pas d’une illustration)).
Nous sommes sensées rencontrer les attentes de notre public. Ce soir un professeur de français est venu avec ces étudiants (des adultes, dont le français n’est pas la langue maternelle) pour leur faire entendre du texte; il a été déçu. Et il était un peu fâché. Il m’a demandé de m’expliquer devant ces étudiants. À sa déception personnelle s’ajoutait, cet ébranlement de sa fonction, de sa compétence, c’est comme s’il devait lui supporter les conséquences de notre «fronde». Une jeune femme qui c’est présenté comme «en exile d’outre quievrain» a aimé notre présentation, mais regretter de ne pas avoir fait la connaissance de «notre» théâtre.
Je suis très content d’être allé jusque-là. La radicalité quand elle nous écarte de ce qui est supposé rencontrer les désirs du spectateur, et donc nous emmener sur un terrain nouveau n’existe pas sans provoquer une certaine anxiété. Et donc heureusement que Gemma et Gregory était là, qu’il avait déjà traversé ce genre de gué.=
Bernard Van Breusegem — 18:44
Avec un jour de retard.
Que nous éprouvions les limites de notre procédé, vu le nombre d’opération blind date successives mis en place, est inévitable. Il y a donc des «contingences», et il y a aussi des impondérables. Ainsi nos idées n’ont de sens, sur cinq jours, qu’à l’aune de leur réalisation possible. Un des impondérables, que nous essayons cependant de pondérer le plus possible, est l’aspect technique, assez différent à chaque fois. Vu les moyens dont nous disposons, certaines idées, excellentes, cependant, s’échouent finalement sur le banc de sable des impossibilités techniques. L’idée sur laquelle nous voguons depuis quelques jours tient la mer. Nous l’avons éprouvée sous le vent de nos considérations, et commencé à en sortir les voiles pour qu’elle puisse atteindre, le jour dit, sa vitesse de croisière.
Mais le récif d’une impossibilité réalisationnelle inattendue vient juste d’éventrer la coque du vaisseau conceptuel que nous avions lancé et il semblerait que nous devions tous sauter dans le zodiac de sauvetage d’une autre idée toujours amarrée au port. Ce vaisseau, on peu présumer qu’il sera un peu moins fringant que le précédent. On n’en sait rien. Il est plus petit, c’est sûr. On y sera un peu plus à l’étroit. Mais on aura plus chaud, vu qu’on y sera plus serré. Cette idée, finalement, sera-t-elle bateau?
Miguel Decleire — 22:59
C’est drôle, (comme le dit Lewis Trondheim, quand on dit « c’est drôle », c’est que c’est pas drôle, et quand on dit « c’est pas drôle », c’est que justement c’est drôle – mais passons), donc, j’ai l’impression que pendant toute cette semaine, nous avons oscillé entre le trop et le pas assez, le foisonnement et le minimalisme. Un sujet ouvert et clair, riche, même si un peu piégé, des idées comme on en a rarement eu, un dialogue nourri et intéressant, beaucoup de pistes, et finalement on a du mal à se restreindre peut-être, on en a choisi une, qui nous plait par son minimalisme et une certaine radicalité, mais c’est la concrétisation qui nous pose problème. Si, comme le disait Dora García, la radicalité, c’est surtout plus pratique, le minimalisme n’est pas le plus simple, ni à mettre en œuvre, ni à concrétiser. On dirait qu’on est engagés dans une sorte de course contre la montre, et en définitive, les choix finaux, c’est le temps qui les prendra pour nous. Il y a déjà toute une série de choses que nous pouvons abandonner, parce que le temps fait défaut. On verra ce qui tiendra le plus longtemps. Certaines choses pourront être réalisées, d’autres non. Une sorte de darwinisme des idées. Est-ce qu’on se serait mis dans une posture de spéculateur ? Faire jouer le temps en notre faveur. Confiance. Jusqu’où est-ce qu’on peut avoir confiance ? Jusqu’où est-ce qu’on peut avoir le beurre et l’argent du beurre ? La réponse demain soir.
Stéphane Olivier — 21:37
Le sujet de cette semaine, c’est celui qu’on a compris le plus de vite. Au point qu’on a douté après, «est-ce qu’on l’avait bien compris?».
Et voilà, pour un jeudi, on n’a jamais été aussi loin du vendredi. On a ramé toute la journée, on avait une bonne idée qui ne marche pas alors on essaye de trouver un plan B, mais pourtant cette première idée était la meilleure. Et tout ça m’a mis dans une humeur massacrante.
Confiance: «Croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle... d’une autre personne, qui fait que l’on est incapable d’imaginer de sa part tromperie, trahison ou incompétence.» Sans doute qu’une des chose que je ne comprend pas c’est cette confiance, cette confiance que j’ai dans mes proches et qui est rarement déçue, cette confiance que j’ai parfois dans des déclarations publiques.
On n’a pas de mal a croire les déclarations politiques pessimiste (je vous engage a lire la déclaration au parlement de Yves Leterme - notre «State of the Union» - c’est tellement catastrophiste qu’on en a même pas vraiment parlé dans les journaux; il a fallu que Bernard l’exhume pour que je la lise), et on ne revient pas dessus. Un puissant ne se trompera jamais quand il est pessimiste.
Est-ce qu’on a le souvenir d’une déclaration politique pessimiste qui se soit révélée fausse?
Seules les déclarations optimistes comme celle de Coolidge (ou celle de Sarkozy sur les subprimes et les emprunts a taux variable pendant la campagne électorale) se révèle-t-elle fausse?
Considérer que les puissants sont victimes d’aveuglement, qu’ils étaient - au moment de leurs déclarations - honnêtes et sincères, n’est-ce pas notre façon d’excuser notre propre aveuglement. Ne faudrait-il pas accepter que de croire - ne fussent qu’un instant - que les puissants (ceux qui ont le pouvoir et la richesse) puissent se préoccuper du bien commun (de façon optimiste ou pessimiste d’ailleurs) est une preuve de cécité. Jugeons des faits.
Souvent quand je suis d’humeur massacrante je relis Cornelius Catoriadis: «Le terme de démocratie se prête évidemment à infiniment plus de discussion, par sa nature même et parce qu’il a été depuis longtemps l’enjeu de débats et de luttes politiques. Dans notre siècle, tout le monde, y compris les tyrans les plus sanglants, nazis et fascistes exceptés, s’en réclame. Nous pouvons tenter de sortir de cette cacophonie en revenant à l’étymologie: démocratie, le kratos du démos, le pouvoir du peuple. Certes la philologie ne peut pas trancher des conflits politiques. Qu’elle nous incite au moins à nous demander: où, dans quel pays, voit-on aujourd’hui réalisé le pouvoir du peuple?» … «La philosophie nous montre qu’il serait absurde de croire que nous n’aurons jamais épuisé le pensable, le faisable, le formable, de même qu’il serait absurde de poser des limites à la puissance de formation qui gît toujours dans l’imagination psychique et l’imaginaire collectif social historique. Mais elle ne nous empêche pas de constater que l’humanité a traversé des périodes d’affaissement et de léthargie, d’autant plus insidieuses qu’elles ont été accompagnées de ce qu’il est convenu d’appeler un «bien-être matériel». Dans la mesure, faible ou pas, où cela dépend de ceux qui ont un rapport direct et actif à la culture, si leur travail reste fidèle à la liberté et à la responsabilité, ils pourront contribuer à ce que cette phase de léthargie soit la plus courte possible.»
(Cornélius Castoriadis; «La culture dans une société démocratique». © Passant n°31 [octobre 2000 - novembre 2000])
Ça me redonne le moral. Peut-être par aveuglement.
Bernard Van Breusegem — 12:07
(Le jour d’après)
Ca fait du bien d’être là. Vraiment. J’avais oublié combien c’était bon de se laisser aller comme ça le soir, de se répandre, d’exploser via un serveur pour apparaître sur autant d’écrans à la fois. Franchement, je vous le conseille. Ca soulage. Tisses, tissez, tissons la toile.
L’araignée éprouve-t-elle du plaisir à sortir son fil? Je parie que oui. Salope.
Foin de toute cette poésie, où est-ce qu’on en est dans la fabrication de ce truc pour samedi. Non, vendredi, merde, j’ai failli me tromper. On aurait jamais été prêt. Ou alors avec un jour de retard.
Eh bien, on avance. On dirait qu’il y a une sorte d’inertie, de force cinétique que le blind date une fois lancé produit, entraîne à sa suite. Non, je déconne, ça serait trop beau. Ce qui se passe, c’est que nos invités nous emmènent à chaque fois, malgré nous, peut-être malgré eux aussi, là où on ne savait pas vraiment qu’on pouvait aller. Ils sont notre coke. Notre qat. Notre metamphet. On les sniffe, on les suce, ils nous sniffent, ils nous sucent. On se deale.
En y repensant, ce que j’ai écrit hier soir «les gens ne lisent pas assez de livres d’histoire», c’est très, trop…enfin, moi, je suis un de gens aussi, et je n’en lis pas beaucoup non plus. Et j’ai toujours ce livre d’Eric Hobsbawm («le court vingtième siècle»), le formidable historien marxiste que je vous recommande, dont j’ai lu l’intro géniale, que j’ai acheté il y a un an et qui me répète avec raison, de la caisse où il se trouve actuellement: «lis-moi», «lis-moi». Mais si j’ai des scrupules, même pour ça, tout le monde n’en a pas, pour le reste, tout le reste. La mémoire, ce bel outil, est formidablement sélective. La mienne aussi. On se souvient peut-être de ce qu’on peut, mais souvent aussi de ce qu’on veut. Et puis on efface le reste, on le balaie, on le dilue, on se conforte, on se rassure. C’est tout ce qu’on a: se rassurer. Y croire. Et si on peut se mentir si facilement, qu’est-ce qui peut bien nous empêcher de mentir aux autres?
Miguel Decleire — 22:48
Alors le mercredi, d’habitude, on trouve une forme concrète à essayer. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui, mais ça ne donne pas ce qu’on pensait. Je ne vais pas vous dire en quoi ça consistait, parce qu’on l’utilisera peut-être. Je vous la dirai (si j’y pense) quand on l’aura abandonnée, si on l’abandonne. On pensait mettre en scène un désastre, et voilà que le désastre n’est pas possible. Ce qu’on a mis en place tient trop bien, aussi incongru que ça puisse paraitre, ça ne se casse pas la gueule comme on voudrait. C’est une sorte de comble, avec un sujet pareil. Mais finalement, vouloir rater quelque chose, c’est la même chose que vouloir la réussir. On ne « veut » pas un désastre, on cherche juste à maitriser une catastrophe, c’est comme ça qu’on a domestiqué le feu, j’imagine. Quand on le maitrise, on peut le déclencher. Peut-être que c’est là un des aspects de la proposition de sujet de Kenneth Bertrams. Comment, pourquoi est-ce que les crises financières se produisent ? Elles sont inscrites dans le système, c’est normal, parait-il, il y a des cycles. Marx aussi en a parlé, longuement, je pense que Stéphane a déjà parlé de la baisse tendancielle du taux de profit (plus on cherche à augmenter les gains, plus les marges de profit sont maigres, ou quelque chose comme ça), je ne vais pas le répéter en moins bien, même si ça augmente mon nombre de mots. On doit donc s’attendre à des crises. C’est normal. Grégory nous a raconté ce matin qu’il connaissait quelqu’un qui avait été assureur, et qui proposait des assurances-vie. Une des conditions pour y souscrire était de payer absolument toutes les tranches. Si le client en manquait une, l’entièreté de ce qu’il avait déjà versé revenait à la compagnie, et il ne gardait plus rien à son nom. La clientèle-cible visée n’était pas les gens qui pouvaient se payer ces assurances. C’étaient ceux qui pouvaient tout juste se les payer. Ceux dont on pouvait penser qu’à un moment ou un autre, ils ne payeraient plus. C’est exactement ce qui s’est passé avec les subprimes. On fait croire qu’il y a un moyen d’accéder à la propriété pour tous. Mais au lieu de redistribuer la richesse réellement, on truque la donne. On vend du vent, comme Enron. Les dernières marges bénéficiaires, conformément à la baisse tendancielle du taux de profit, il faut aller les chercher chez les plus pauvres. Les subprimes, la spéculation sur les récoltes alimentaires. J’ai l’impression que tout ça a lieu parce que le principe est que le gagnant est celui qui va le plus vite, un peu comme dans les pyramides, où on reçoit une lettre, on doit la renvoyer à 5 autres personnes et on donne 5 € à celui qui l’a envoyée. Ça marche quand on est au début. Et puis c’est la banqueroute. Ceux qui jouent à ça le savent. Le tout est de le faire croire aux autres qu’ils sont gagnants le plus longtemps possible. Aux petits porteurs, aux petits portefeuilles. Ceux qui sont là pour perdre.
Il vaut mieux jouer au loto. C’est plus sûr.
Stéphane Olivier — 22:13
«L’insurrection qui vient», ce soir je regardais un bref instant «C dans l’air» sur France 5, le débat s’intéressait à l’ultragauche. Les destructeurs de caténaires en font semblent-ils partie. Ils ont cité un livre «L’insurrection qui vient», je trouve le titre joli. Proudhon parlait de l’insurrection comme du droit revendiqué de se soulever contre l’autorité légale lorsqu’elle va contre la volonté populaire ou les intérêts du peuple.
Et juste après mon fils de 9 ans, m’a demandé ce que c’était que le terrorisme. Je lui ai lu 2 définitions qui étaient dans le dictionnaire: «Emploi systématique par un pouvoir ou par un gouvernement de mesures d’exception et/ou de la violence pour atteindre un but politique.»; «Ensemble des actes de violence qu’une organisation politique exécute dans le but de désorganiser la société existante et de créer un climat d’insécurité tels que la prise du pouvoir soit possibles.» puis on a essayé de trouvé des exemples; dans Harry Potter, Voldemort et sa clique sont des terroristes, et puis la bande a Baader, la RAF, etc.
«In petto», je me suis demandé avec quel degré de terreur (sur l’échelle de Robespierre) je ressentais la menace de la crise, celle de la fin de la Belgique, du réchauffement climatique, de la baisse de mon pouvoir d’achat… et surtout mon incapacité d’agir.
Côté studio, on a un peu du mal; jusqu’ici…
Je pense que c’est surtout par ce qu’on ne sait pas nous même ce qu’on doit penser de cet aveuglement sur lequel nous interroge Kenneth Bertrams. Et donc, que choisir parmi le foisonnement de propositions qui sont nées depuis lundi (a-t-on déjà eu autant d’idées)?
Celui qui voit (le puissant, ou n’importe qui?) ne sait pas voir. Que faire pour guérir l’aveuglement de celui qui voit? Que doit-on faire? Montrer notre propre aveuglement? On nous cache tout, on ne nous dit, rien?
Calvin Coolidge, président des USA, auteur de la déclaration d’état de l’union qui est notre sujet cette semaine, était républicain. Il avait été élu avec 54, 1% (un meilleur score qu’Obama). Il était partisan du «laisser-faire» libéral et a été un des premiers présidents à utiliser la radio. Il n’était sans doute pas aveugle, peut-être crédule, peut-être convaincu, mais pour autant est-ce qu’il ne savait pas?
Bernard Van Breusegem — 12:42
Je suis celui qu’on attendait déjà plus. But I’m back.. And i’ll be back tous les jours avec un jour de retard. Pas moyen de faire autrement.
«Quoi!» s’étonnent les innombrables lecteurs de ce blog, «déjà»?
Eh oui… Tel Rocky (Balboa) dans le film éponyme, et selon une dramaturgie maintes fois éprouvée, je reviens, après un douloureux passage à vide, et au prix de rudes efforts. Ça m’a pris le week-end, mais je suis là, plus fringant que jamais. Musique. Je passe donc outre tout ce qui essayait de me retenir dans mon élan artistique pour vous parler de ce qui nous occupe cette semaine, avec nos invités danseurs.
Nous avons donc un commissaire historien et une question historique. Comme la psychologie, L’Histoire travaille a posteriori, mais elle n’a d’intérêt, en fait, que si elle nous éclaire sur certains mécanismes, comment ils se répètent, et ce qui fait qu’ils se répètent. On pense qu’on change beaucoup, qu’on évolue sans arrêt, à une vitesse ahurissante, ce qui n’est pas faux, culturellement parlant. Mais les mécanismes de base du système, eux, ne sont pas très différents. Le capitalisme, par exemple, a, dans ce siècle, engendré, appelé des conduites et des attitudes identiques. C’est évident. Mais on feint de ne pas le voir, et on préfère se dire: «on est (post) moderne et ce sera différent ce coup-ci». Pas sûr. Avec Greg et Gemma, nous travaillons donc sur la confiance, et plus loin, sur l’aveuglement (C’est drôle comme, presque chaque fois, les sujets qu’on traite parlent à la fois de nous produisant un spectacle, et de la question en elle-même). Cette confiance qu’on donne, et celle qui finit par se monnayer.
La confiance est un élément clé du capitalisme. C’est même quelque chose qui fait que l’homo economicus, l’homme (consommant) n’est pas réductible à une équation. N’en déplaise à certains, l’économie n’est toujours pas une science exacte. (L’Histoire non plus d’ailleurs, mais elle est autre chose que du story-telling). Pour que le système marche, on demande donc la confiance des clients. On leur vend des produits qu’on leur dit être dignes de confiance. Même quand ils sont pourris. Et les tenants du système (il y a des aboutissants, c’est sûr) proclament sans arrêt leur confiance dans la chose. Et quand ça s’écroule, ils font semblant de s’étonner que ça soit pourri. Mais tout ça va changer, c’est sûr. Plus jamais ça.
Les gens devraient lire plus de livres d’histoire.
Miguel Decleire — 23:56
Aujourd’hui c’est mardi, c’est le jour du bouillon. C’est normal, il ne faut pas s’en faire. Les bonnes idées ont du mal à se mettre ensemble, j’ai été peut-être un peu enthousiasme hier, mais il ne faut pas s’en faire, c’est normal, ce n’est que normal. C’est mardi. En fait, même si on ne sait pas encore du tout où on va, on sait qu’on y va, et qu’on finira bien par trouver quelque chose. On ne sait pas encore juste quoi. Mais on peut être rassurants. Le sujet est peut-être un peu plus difficile que prévu, le dernier discours de l’État de l’Union de George Dubya Bush est un peu plus circonspect que celui de Calvin Coolidge, il a tout de même des euphémismes qui avec les circonstances prennent leur pesant d’ironie dramatique (vous savez bien, le fait que le spectateur en sait plus que le personnage, qui lui ignore qu’il dit des bêtises, et qu’il va au casse-pipe) : « Pour construire un futur prospère, nous devons faire confiance aux gens avec leur propre argent et leur donner le pouvoir de faire croitre notre économie. Au moment où je vous parle, notre économie passe par une période d’incertitude. L’Amérique a augmenté son volume d’emplois durant une période record de 52 mois d’affilée, mais ils progressent à un rythme plus lent. Les salaires montent, mais aussi les prix de la nourriture et de l’essence. Les exportations augmentent, mais le marché de l’immobilier a décliné. Aux tables de cuisine à travers le pays, on est préoccupé par notre futur économique. » Peut-être ses conseillers ont-il fait preuve d’un peu plus de clairvoyance, ou de prévoyance. D’honnêteté ? Qui sait... Mais aujourd’hui où des quartiers entiers sont mis en vente avant même d’être achevés, ces considérations n’ont l’air que de rassurantes préoccupations. C’est bien de rassurer en tenant compte de l’inquiétude du citoyen, mais mesuraient-ils déjà à quel point il avait raison ?
Tiens, j’ai vu ce soir le filage de « Living », la création de nos amis de Tristero, qui aura sa première jeudi. Et il y a au moins en commun avec notre sujet de cette semaine qu’il traite de l’imminence de désastres que rien ne laisse supposer – sauf les couleurs tristement marrons du décor, qu’on affectionnait dans les années 70. Tiens, l’époque où on parlait tout le temps de la crise la radio. Un jour on a arrêté, sans doute parce qu’on était habitué.
Stéphane Olivier — 21:21
«Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’oeil de ton frère? Et la poutre qui est dans ton oeil à toi, ne la vois-tu pas? Comment peux-tu dire à ton frère: mon frère, attends, que j’enlève la paille qui est dans ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d’abord la poutre de ton oeil; et alors, tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’oeil de ton frère» (Lc 6, 41). Je pense n’avoir aucun lien de parenté avec un dirigeant, états- unien ou autres. Pourtant, mettre sur mon manque de goût pour l’histoire mon incapacité (la nôtre) à anticiper la crise actuelle, ne serait-ce pas comme confondre la paille et la poutre.
Il y a-t-il (hors de la question biologique) une différence entre être aveugle et porté des oeillères. Ce strorytelling permanent; «Ça va être dur, mais c’est pour que ça aille mieux bientôt», «Il faut garder espoir;», «D’autres que vous sont en bien plus mauvaise posture.», «Les choses vont changer.» est-il vraiment crédible? endort-il ma volonté? ou bien est-ce que comme dans un accord tacite j’accepte cette bouffée d’oxygène alors même que je sais que la noyade est proche.
Ou bien est-ce que voilà le danger? Toujours tout dramatiser. Tomber de Charybe en Scyla, de l’optimisme aveugle au pessimisme paralysant. Sans penser que la raison et les faits soient supportables. Je ne peux que remarquer que ni Charybe (l’optimisme irraisonné), ni Scylla (la peur) ne sont des positions très dynamiques.
Aujourd’hui nous avons hésité, quel est le vrai sujet? L’aveuglement par ignorance, l’aveuglement volontaire, l’aveuglement des classes dirigeantes, l’aveuglement tout court ou est-ce le cycle des crises financières, la répétition toute court.
Et jusqu’où vendredi le public sera-t-il d’accord de nous suivre. En juin malgré les cris des Cassandres ne pensions-nous pas tous que «ça allait aller», somme-nous prêt à entendre que nous savions ou que ne pouvions savoir ou nous douter «que ça n’allait pas».
Bernard Van Breusegem — 15:19
«Trois cents mots». Je pourrais ne mettre que ça comme texte, ne dire que ça, «trois cents mots» puisqu’on s’est engagé à mettre ça en ligne quotidiennement. Une pirouette pour s’en sortir. Dois-je m’en sortir? Oui, j’avoue: mes bonne intentions, mon engagement sur l’honneur, presque ce projet de vie d’écrire tous les jours tourne à rien, s’écroule, et je suis minable, perdu, déshonoré. Ai-je des excuses? Oui, plein. Plein de bonnes. Des valables. Avec ce déménagement, plus une minute à moi pour faire quoi que ce soit, à part conduire la petite chez ses grand parents, la conduire chez le pédiatre, ouvrir des cartons, monter des meubles, nettoyer l’ancienne maison, y boucher les trous, blanchir les joints du carrelage, fixer la porte des wc’s, faire l’état des lieux, attendre le plombier, remettre les appliques de l’ancienne propriétaire, voir le nouveau locataire pour les formalités, attendre le ramoneur, engueuler au téléphone le ramoneur qui n’est pas venu. Alors quoi? Alors, rien. Sinon que je vole, oui, je vole au temps de travail commun, à ces cinq jours comptés, le temps d’écrire ceci, à 15H07. Voilà où j’en suis. J’ai honte. Mais ça passera. J’espère. Et puis un jour, belgacom rétablira ma connexion, et mon texte sera de nouveau bien rangé à côté des autres, et je serai de nouveau pleinement heureux. Un jour.
Miguel Decleire — 23:13
Finalement, une des choses les plus idiotement rigolotes pour nous dans ces Blind Dates, c’est qu’on peut faire impunément toutes sortes de choses qu’on ne ferait pas nécessairement dans des circonstances plus « normales ». Vendredi passé j’ai lu un discours en espagnol, et tout engagé qu’il était, je me suis tout de même amusé à le faire avec l’accent latino, la semaine passée j’ai couru tout nu, celles d’avant j’ai fait parler des machines, encollé du papier craft, fourré du papier dans une broyeuse à branchages avec de la passata en uniforme nazi (enfin une évocation) ; je pense n’avoir jamais fait autant de trucs bizarres en si peu de temps et avec autant de décontraction dramaturgique. Et cette semaine, on ne dirait pas que ça va s’arrêter. C’est déjà parti dans tous les sens, c’est la magie du lundi, on peut se permettre de gamberger tous azimuts, ça ne prête encore à aucune conséquence. Il y a une piste ou l’autre qui commencent à se dessiner, l’aveuglement est un thème qu’on peut travailler sur le plateau de mille et une manières ; l’imminence du désastre est pleine de ressorts comiques potentiels, et la décontraction avec laquelle on peut le traiter, riche d’ironie dramatique, d’autant plus forte qu’elle sera consciente, pour le coup. Quoi que nous fassions, nous serons pris dans quelque chose d’autre, dont peut-être qu’il vaut mieux rire tant qu’il est encore temps. Par exemple, allons-nous danser ou pas ? Ah, il est encore trop tôt pour le dire. Mais peut-être. Mais peut-être pas.
Pour revenir un peu au sujet, je me suis dit tout à l’heure qu’il n’y a qu’aux États-Unis qu’on peut parler de discours sur l’« état de l’Union ». En Belgique, par exemple, personne ne se risquerait à faire une chose pareille. D’une certaine manière, toutes les déclarations politiques pourraient porter ce titre. Mais pour en faire un vrai, spécifiquement sur le sujet, c’est proche du suicide politique. Quant à l’Europe... qui se sentirait de taille à l’assumer ? Sarkozy en serait bien capable.
Stéphane Olivier — 23:04
Comme sujet; un extrait du discours annuel sur l’état de l’Union de Calvin Coolidge, président des États-Unis (4 décembre 1928). «Il s’agit d’une référence classique (des historiens) pour décrire l’aveuglement des dirigeants et de l’élite US à quelques mois de la crise». Aveuglement (au fig. Fait de priver quelqu’un de discernement de sens critique; état d’une personne privée de discernement, de sens critique (notamment sous l’empire de la passion)).
Bernard a retrouvé ce matin un petit dessin extrait d’un journal américain cité par le monde, d’un côté sous le chiffre 1929 on voit un homme en frac (un capitaliste des caricatures du début du siècle) sauter dans le vide du haut de la bourse de New York, de l’autre côté dans le même décor, mais sous le chiffre 2008, le même homme en frac jette dans le vide des messieurs tout le monde, des quidams.
Profit privé, perte publique. Du fric pour certaines des dettes pour tous.
Je revois mon père m’expliquant la fin programmée du capitalisme par la baisse tendancielle du taux de profit, et que les crises successives sont comme les attaques cardiaque d’un organisme aux coronaires de plus en plus usé. Je pense qu’à chaque soubresaut du vieil animal il espérait des lendemains qui chantent. C’est d’abord a lui que j’ai pensé, il y a quelques
semaines, content qu’une énième déception lui soit épargné.
Cela faisait un an, qu’on commençait a entendre que des travailleurs était prêts à faire grève pour obtenir des augmentations de salaire, et plus seulement pour empêcher que ferment leurs entreprises. Même le chômage commençait à baisser.
Est-ce que cela pouvait vraiment duré, est-ce que la peur du lendemain pouvait reculer sans risquer de redonner conscience…
Je me suis rappelé ce que m’avais dit P, il doit y avoir 20 ans, un copain skateur (devenu trader, je crois); «le marché spéculatif, se comporte comme un marché à somme nulle, le profit des uns correspond aux pertes des autres. À terme il s’asphyxie, il cherche donc à prendre l’air. En cherchant de nouveaux marchés. En ouvrant le marché aux petits épargnants qui seront pressés et ponctionnés, puis en s’appropriant l’argent de tous par le biais d’une intégration du bien public».
Aveuglement, bêtise, incompétence, hypocrisie… Je ne veux croire qu’hier, comme en 1928, les puissants (peut-être pas les élus) ne se servent pas de la crise comme d’un outil, d’un moyen pour accroître encore leur puissance.
La question qu’on peut se poser, c’est si la naïveté du discours de Calvin Coolidge en 1928, comme celui de Nicolas Sarkozy en 2007 (soyons reconnaissants aux «problèmes communautaires» de nous épargner ce genre de pensum), est une preuve objective de leurs malignités plus que de leurs aveuglements.
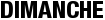
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)

.gif)