Miguel Decleire — 23:40
Je pense que le principal sujet de la semaine, c’était l’instrumentalisation de la parole. Il n’est pas possible de parler des sans-papiers sans mettre en jeu des sous-discours, des autres niveaux de discours, des méta-discours à l’infini. Ça m’a frappé quand nous avons été rendre visite au 133 jeudi. Nous représentions, sans le vouloir, les médias. Un autre média, pas la télé, pas la radio, mais peu importe. Tous les médias sont bons pour se faire entendre. Et ils nous ont parlé comme si nous étions les médias, je me suis senti dans la peau d’un journaliste, recueillant la parole qu’ils pensaient qu’ils fallait dire – c’était la grande question qui nous était posée: Ça va comme ça? Comme si c’était nous qui étions les garants de la validité de leur parole. Loin de moi tout jugement, d’ailleurs, toute prétention de savoir ce qu’il aurait fallu qu’ils disent. Qu’est- ce que je pouvais en savoir? Mais poser la question, ce n’était pas donner l’occasion de libérer une parole, mais demander une réponse. Nous nous sommes bien vite aperçu, Vladimir et moi, que nous ne sortirions pas de là, quoi que nous fassions. (Sans doute étions-nous bien maladroits. Au moins nous pouvons l’avouer, nous ne sommes pas des journalistes, et nous sommes en droit de faire état de nos errements.)
La situation s’est encore complexifiée quand ceux qui se sont présentés à nous participaient à des projets de théâtre. Il ne s’agissait plus alors de parler de soi de témoigner de son vécu personnel, mais de renvoyer au spectacle qu’il faisait, comme une sorte d’hyperlien. Le théâtre avait déjà entrepris la mise en abime de cette parole, et par notre intervention, se poursuivait d’un cran. Et un peu plus loin, lorsque j’ai abordé un groupe d’Équatoriens en train de peindre de gigantesques banderoles sous le titre de «Les oiseaux migrateurs», quand je leur ai proposé de parler, ils m’ont répondu qu’ils faisaient un spectacle la semaine prochaine, et que nous étions les bienvenus pour y participer. Ils avaient sans doute bien compris les mécanismes d’appropriation du message, et tenaient à le maitriser eux-mêmes, et n’avaient pas tort.
Il m’a semblé d’abord étrange qu’ils se placent sur le même pied que nous, comme des collègues, à nous servir les uns aux autres de caisse de résonance, je ne m’y étais pas attendu du tout. Mais après tout, c’est la même chose que vivent les compagnies qui se cherchent un public, il est normal de se tisser des réseaux de communication entre «confrères». Voilà que nous étions confères. D’accord, mais de quoi parler? Le contenu est bien sûr évident, quand il s’agit des sans- papiers, ils sont eux-mêmes le contenu de leur propre message, il est naturel qu’ils soient embarrassés de se trouver une parole ; le sujet, c’est qu’on tente évidemment par tous les moyens de les oublier. Le vrai problème n’est pas «les sans-papiers» chez les «avec-papiers» évidemment. Je pense que c’est ce que nous avons essayé de montrer, c’est qu’il n’y a pas de dedans et de dehors, il n’y a pas deux mondes dont il faudrait souligner la frontière. Il n’y en a qu’un, il n’y en a jamais eu qu’un, et c’est le problème de notre monde à tous.=
Stéphane Olivier — 01:35
Et si j’écrivais mon billet maintenant me suis-je dit à l’instant.
Dora Garcia nous a dit un jour ; «être radical c’est surtout pratique». C’est vrai. Et pour le sujet de cette semaine, il a été utile d’être radical. En discutant au début de la semaine ce qui nous est tout de suite apparu comme le principal écueil de ce sujet était l’impossibilité pour nous d’inventer, de «jouer» la parole des sans- papiers. Quand nous avons écrit «Chômage», nous étions chômeur, nous pouvions nous approprié la parole des chômeurs sans crainte de l’instrumentalisé. Nous pouvions aussi mesurer les difficultés de vivre chômeur. Nous ne sommes pas des sans-papiers, nous n’avons jamais tout quitté parce que pour vivre il fallait fuir. Les sans- papiers resteront sans voix, surtout parce qu’il n’y a personne pour les écouter. En allant au 133, j’ai eu l’impression que les sans- papiers eux-mêmes avaient instrumentalisé leur parole, qu’il la contenait pour qu’elle corresponde à ce qu’il nous faudrait entendre pour trouver leur demande légitime. Loin de ce qui je pense doit être ce qu’il ont vraiment à dire. Parce qu’en fait pourquoi devrait-il se justifié. Leurs seule présence devrait en dire assez.
Ce soir donc la proposition était (à nos yeux) radicale. Envisager la question des sans-papiers comme drame humain n’est pas suffisant, nous savons tous que ces gens souffrent, et rien n’a changé. Envisager la question des sans papier comme phénomène économique n’est pas suffisant, plusieurs analyse au démontrer la nécessité d’une nouvelle immigration, et rien n’a changé. Envisager la question des sans- papiers comme une question de droit n’est pas suffisant, car comme William Gaddis l’écrit au début du «Dernier acte»; «La justice? Tu auras la justice dans l’autre monde, dans ce monde tu as la loi». Envisager la question des sans-papiers comme une question politique n’est pas suffisant. Envisager la question des sans-papiers comme une question historique n’est pas suffisant.
C’est l’impossibilité de se faire «une» image, comme on pourrait se raconter «une» histoire ou se faire «une» idée du problème qui nous a conduits a proposé un propos qui témoignait de tout ça.
Une chose cependant, qui s’éloigne un peu…
On ne choisit pas d’être Belge, on ne peut pas choisir d’être apatride. On peut quitter la nationalité belge pour une autre. Mais choisir d’être un apatride vivant en Belgique est interdit. Le droit international considère que chacun doit avoir une nationalité, que chacun doit appartenir à un état; qu’être apatride ne peut être qu’un état de transition.
Instinctivement je me demande si ce lien entre état-nation et identité individuelle n’est pas finalement au coeur du conflit entre ces migrants et nos états.
Miguel Decleire — 23:03
Encore un peu plus de concret aujourd’hui. Vladimir et moi avons été rendre visite aux sans-papiers regroupés chaussée d’Ixelles, pendant que Stéphane allait interviewer un ami avocat de sans-papiers. On a pris une petite caméra, au cas où. Si ils voulaient nous partager ce qu’ils diraient à la RTBF s’ils avaient le micro du journal du matin. L’ambiance était calme, on a discuté avec quelques unes des personnes qui étaient là. L’un complètement désabusés, sur l’action, et même au-delà, sur les années à venir, qu’il voyait très sombres ; un autre, quand on lui a demandé ce qu’il attendait de leur action, a eu cette réponse très claire : la loi. Ils travaillent, ou bricolent, tous, ils participent déjà à notre économie, il ne leur manque qu’un document pour les autoriser à faire ce qu’ils font déjà, depuis longtemps, plus dur et pour moins cher que les autres ; l’idée générale est qu’ils ont choisi la clandestinité, mais non, ce sont eux qui réclament la loi, une loi. Mais le flou a souvent arrangé tout le monde, en Belgique. L’économie libérale, d’ailleurs, ne pourrait pas fonctionner, pas aussi bien, sans une part d’ombre, de travail en noir. Sans doute que c’est nécessaire pour huiler un peu les rouages. On a retrouvé Mohammed, que Stéphane avait rencontré hier, il s’est prêté au jeu de la caméra et du journal parlé du matin avec beaucoup de courage, et il a bientôt été suivi par quelques autres. Des choses à dire, ils n’en manquent pas. Après avoir épluché les directives européennes, et autres textes officiels, leurs paroles prennent évidemment un autre poids. Elle les fait rire, la ministre qui parle de sa « porte de derrière ». La plupart en ont une, de porte, avec une famille derrière, ils voudraient juste pouvoir la fermer le matin en étant sûrs de la retrouver, et le soir d’aller se coucher l’esprit en paix. Même si ce n’est pas une coquette villa de Puurs.
Stéphane Olivier — 22:04
Aujourd’hui, alors même que je n’ai pas si bien dormi, ou pas assez… j’étais en forme. Je me suis coupé les cheveux ce matin, ça me fait toujours un effet tonique. Comme souvent le jeudi soir je n’ai rien envie de dire, sans doute par ce que je ne veux rien dévoilé de la représentation de demain. Nous ne connaîtrons pas notre texte par coeur, en 5 jours, surtout si on met trois jours à préciser le contenu. Et donc, la forme prend en compte cette contrainte, ce qui dans le cas de cette absence de parole donnée au sans-papiers est assez cohérent. On a divisé les taches aujourd’hui, Miguel et Vladimir sont retournés au 133, Bernard est resté au studio pour faire de la technique et moi je suis parti interroger un ami avocat spécialisé dans le droit des étrangers. On saura demain ce que ça donne.
Mon ami m’a expliqué que c’est en 1974 qu’on a mis fin en Belgique à l’immigration justifiez par le travail, si un étranger arrivait en Belgique en affirmant qu’il venait pour travailler on lui attribuait un titre de séjour. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Aujourd’hui l’immigration économique n’est plus tolérée, il faut une justification «humanitaire» ou «politique». Il faut avoir le statut de réfugié, ou si on ne l’a pas, réunir un grand nombre de conditions pour obtenir son titre de séjour et donc avoir le droit de travailler, de vivre.
Il m’a aussi expliqué que c’est un sujet hautement politique, maintenant que plusieurs partis surfent sur la vague des revendications habituellement chassent gardées de l’extrême droite, il n’y aura sans doute pas de régularisation avant les élections régionale.
Tout cela est lié à la notion de droit du sol, de territoire. Comme les animaux nous défendons notre territoire. Il y a même une confusion entre l’état et le territoire en droit international.
On cite beaucoup Kennedy en parlant de Obama, pourtant c’est Kennedy qui à dit: "Ne demandez pas ce que l’État peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l’État ". Ce qui reste pour moi un contresens.
Bernard Van Breusegem — 21:34
Cinq jours pour faire un spectacle. C’est peut-être un peu trop. Peut-être qu’on réfléchit trop, qu’on a trop le temps de réfléchir à comment armer le bras qui va lancer le projectile.
Le metteur en scène Peter Zadek raconte dans «mise en scène, mise à feu, mise à nu» que dans un théâtre régional anglais où il avait travaillé, ils montaient 52 pièces par an, une par semaine. En fait, ce qui nous manque peut-être pour arriver à un résultat plus probant est un bon souffleur. On va y réfléchir pour les cinq blind date qui restent.
En tout cas cinq jours, c’est ce qu’on a, et pour émuler un semblant de compétition (ça me reste du blind date précédent, où on a joué au foot post-moderne), je vais écrire la suite de ce texte en cinq minutes. On va voir ce qu’on va voir. Voilà il est très exactement 21H25, et je commence. Il faut dire aussi que j’écrit à deux doigts et que ce n’est pas la méthode la plus rapide pour écrire. En fait le stylo seraitmieux. Et en +, coment soccuper de lortografe quand ikl vous resxte, quandil est déjà 21H2649 et que vous n’avez encore rein dit de bon alors que vous avezquans même une bonne idée. Tout le monde sait maintenant que je déménage et donc, je voulais parler du fait qu’on a toujours beaucoup plus qu’on ne croit, même à 21H2822, et que jke lisais tout à l’heur dans iun rapport de la fondation robert schumann que il y avait 25pays riches et 175 en voie de développemeznt. C’est très moralisateur surtourt à 21H2946, mais les pays riches, ils o, nt suremment plus qu’ils ne croient. top 21H3016 seconde.
Miguel Decleire — 23:47
Aujourd’hui, je me rappelle que je suis moitié belge et moitié autre chose. Par ma mère, je suis un immigré de la deuxième génération. (Et par mon père, un Bruxellois de la troisième.) Mais ma mère n’était pas une immigrée économique. Elle cherchait juste un monde un peu meilleur, à 18 ans elle aspirait à respirer un air un peu moins fétide que celui qui embaumait la dictature national-catholique espagnole. Elle n’a pas eu de problème pour venir faire des études pourtant, et malgré son peu de ressources financières. Peut-être parce que sa famille avait été du côté des vainqueurs dans son pays – même si cette victoire lui avait couté un père, et que la famille, depuis, n’avait plus les moyens de son statut social ; ce que l’État restauré n’avait pas daigné reconnaitre, comme si ce sacrifice n’avait été que normal envers la nécessité supérieure de l’État. C’était la récompense amère des gagnants. Mais sans doute, tout de même, une récompense. Elle n’a pas eu de problème pour s’intégrer dans la société de son pays d’accueil et, même si elle tirait le diable par la queue et devait compter ses centimes pour tenir jusqu’à la fin du mois, elle a pu faire des études et n’a jamais été déconsidérée en tant qu’étrangère. Après tout, elle venait du même pays que la reine. Mes frère et sœur et moi avons été élevés dans la conviction que les « bâtards » sont plus vigoureux que les pur-sangs, que le brassage génétique et culturel rend plus fort, plus ouvert et plus clairvoyant sur les choses vraiment importantes que les visions borgnes des gens qui ne viennent que d’un seul monde. Mais d’autres n’ont pas eu le privilège de vivre les choses de cette façon. Dans une autre partie de la ville, d’autres espingouins, mineurs asturiens et autres immigrés qui fuyaient d’autres fléaux qu’une vie de province étouffante, dont la vie était mise à prix ou ne valait plus très cher chez eux, ont dû malgré ça faire leurs preuves dans le même pays d’accueil, peut-être parce qu’ils appartenaient à la moitié déchue de leur pays, celle qui avait pris leur parti, mais surtout, et avant tout, parce qu’ils n’étaient que des ouvriers, et qu’ils le restaient. Ce n’était pas le pays, mais le niveau de misère qui traçait la frontière.
Aujourd’hui, l’Espagne a changé, et dans sa langue, entre autres, s’édictent au parlement européen de Bruxelles, au sein du chœur des nations européennes, les directives à l’encontre des réfugiés qui viennent du continent qu’elle a colonisé il y a si longtemps, et qui continue de l’accueillir, comme le rappelle le président Evo Morales. Il est curieux de constater que les différences de langues sont des barrières quand elles peuvent restreindre les accès, mais lorsqu’une même langue pourrait les ouvrir et créer des ponts, elle ne le fait pas. Preuve que ce n’est pas la différence de culture ou la difficulté de compréhension qui trace la frontière, mais plutôt ce qu’on doit peut-être se résoudre à appeler, encore, faute d’un terme plus adéquat, la lutte des classes.
Bernard Van Breusegem — 23:32
Laissez-moi vous parler des contingences. C’est le mot que Dora Garcia (avec qui nous avons travaillé sur «vernissage» et «games people play») utilise pour parler de sa vie familiale.
Il se fait que, ma petite famille et moi, nous sommes en période de migration. Pour parler plus simplement, nous déménageons ce samedi. Quand on part, on fait ses valises, et quand on déménage, on fait des cartons. Mais je dois dire que je n’en fais pas beaucoup, occupé que je suis à tous ces «blind date». Et ça m’angoisse: je laisse toute la charge de travail à ma compagne Nathalie. Il semblerait bien que l’exigeante maîtresse que nous avons nous-mêmes sollicitée nous laisse pour le moment peu de temps pour les contingences. En tout cas, elle ne permet point le congé pendant la semaine, même un jour, ce qui me serait bien utile pour les susdits cartons et pour le reste. Mea culpa, mea maxima culpa: l’écriture de ce billet du soir devrait couler de source, mais c’est beaucoup moins évident qu’il n’y paraît –pour ma part, en tout cas-, évidemment, je devrais être plus radical, y aller à la hussarde, sabre au clair, me foutre du style comme de l’an quarante, foncer les yeux fermés, (blind date, quoi), mais jusqu’à ce soir, c’était un échec cuisant. Et tout d’un coup, ce soir, parce que Lili souffre d’une pharyngite qui a nécessité son examen par un pédiatre et que la recherche de son médicament nous a vu faire deux pharmacie de garde et que tout cela nous a mené jusqu’à des heures indues, je me lâche, je me laisse aller, j’oublie en toute connaissance de cause de rendre compte du travail du jour sachant que deux autres plumes ( oui, ils écrivent encore à la plume, et dans des carnets moleskine, ils sont très chics) étançonnerons le toit branlant de ma pensée qui devrait analyser ce que nous avons fait aujourd’hui en compagnie du Sieur Léon. Et laissez-moi vous dire que ça risque d’être comme ça au moins jusque samedi, et p’têt même après, sachant que ma connexion internet risque d’être coupée jusque mardi ou mercredi, dixit belgacom. Et je fais comment pour mettre les textes en ligne, moi? J’ai déjà des solutions, je vous en parlerai peut-être les jours qui viennent. Si je trouve le temps. Bon faut que j’y aille, j’ai douze poubelles à sortir, deux chaises, une friteuse et un vieil halogène à aller jeter dans le container voisin.
Stéphane Olivier — 22:39
C’est un noir, donc un immigré qui est président des USA, les vrais Américains étant jaune (si la théorie d’un première occupation par des populations originaires d’Asie (en passant par le détroit de Béring ou par l’Océanie) se vérifie) ou blanc si on en juge de la couleur des précédents présidents. Bill Clinton a déclaré il y quelque temps qu’«Obama est l’avenir des USA», et donc l’avenir est en marche.
«L’essentiel pour un homme politique est de savoir manœuvrer en donnant satisfaction aux besoins immédiats les plus impérieux de la majorité de la population. En ce qui concerne l’avenir, les masses se fient à ceux qui les persuadent qu’ils représentent leurs intérêts mieux que les autres.» comme l’a dit Staline (dans ces mémoires), dont le cynisme donne (comme Einstein l’a démontré pour la bêtise) un sens à l’infini.
Ce soir en dehors de nos heures de travail (il y a du laisser-aller), Vladimir et moi avons été au 133 de la chaussée d’Ixelles avec l’idée de savoir ce que des sans-papiers dirait au journal du matin de la RTBF s’ils en avaient l’occasion. L’ambiance y était un peu fébrile, hier 439 personnes ce sont inscrites, aujourd’hui sans doute 100 de plus. Il n’y aura pas de place pour tout le monde. Je ne sais pas quel est le deal avec Willy Decourty, le bourgmestre qui soutien l’initiative (d’après les occupants) ni surtout avec le promoteur propriétaire du bâtiment. La gentrification d’Ixelles est en marche et je n’ai pas l’impression que Willy Decourty la combat avec beaucoup de véhémences. Et le «Win-Win» est tellement à la mode. Ce deal comprend une limitation du nombre de personnes qui peuvent occuper le bâtiment et semble-t-il une limite dans le temps (6 mois - jusqu’à l’élection?). Et Sibelgaz dont les bureaux sont toujours dans les bâtiments a demandé aux occupants de ne plus loger au rez-de-chaussée, la vue des sans-papiers gênerai ces employés (c’est ce qu’on nous ont dit).
On a un peu discuté avec Mohamed qui est algérien et qui vit et travaille en Belgique depuis 9 ans. Il travaille à Malines, parle flamand, a une maison, une famille, a un emploi déclaré et pour lui ce qui le différencie de ces collègues; c’est qu’il ne part pas en vacances. Quand on lui a demandé ce que tous ces gens venaient chercher en Europe, il nous a d’abord répondu qu’ils n’étaient pas là pour: «voler, ou détruire l’Europe ou faire du désordre», puis il nous a dit que tous était là pour avoir un avenir.
Miguel Decleire — 23:40
Depuis hier, une question me tourne dans la tête : Qu’est-ce qu’ils menacent, ces sans-papiers, ces illégaux ? Pourquoi font-ils si peur ? Au nom de quoi les refoule-t-on, les sélectionne-t-on ? Le prétexte, c’est que leurs papiers ne sont pas en règle, qu’ils n’ont pas suivi les règles pour la circulation des personnes sur cette planète. Ça tombe sous le sens, on ne quitte pas son pays n’importe comment, on n’entre pas comme ça dans un autre pays. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être comme ça ? D’accord, il n’y a pas si longtemps, les pays s’opposaient violemment les uns aux autres, et c’est encore le cas dans la plupart des coins du monde. Les communautés ont le droit de se défendre des communautés qui leur veulent du mal. Mais cette vision est un peu dépassée aujourd’hui il me semble. Elle était valable tant que les communautés étaient autonomes les unes par rapport aux autres, mais c’est loin d’être le cas aujourd’hui. La planète est enveloppée tout entière dans une économie globale, les communautés différentes sont interdépendantes au sein d’un capitalisme globalisé. Ce capitalisme produit des richesses pour les pays riches, et tire ses ressources des pays pauvres, dont il infléchit l’économie pour obtenir ses richesses, en leur faisant croire que l’exportation est bien plus profitable que l’autosubsistance. En échange, ils font miroiter le modèle capitaliste occidental, et puis s’indignent de ce qu’il fascine les populations qu’ils ont déshéritées au point qu’elles aussi veulent y tenter leur chance, et s’exporter eux-mêmes. Oui, mais ça, ça ne va pas. Si le capitalisme est international et au-dessus des nations et des nationalités, il a encore besoin d’elles. Le capitalisme globalisé survivrait-il dans un pays planétaire, un État mondial ? Je ne pense pas. Une seule monnaie ? Plus de taux de changes ? La libre circulation des citoyens pauvres ? Impossible, tout le système s’écroule. C’est cela que les « nationalités » défendent aujourd’hui, me semble-t-il, car c’est bien sur celles-ci que tout le système repose. Mais que signifie au fond la « nationalité » ? L’appartenance à une « nation », c’est-à-dire un groupe de personnes qui partagent la même idée d’appartenance, et tiennent à la défendre vis-à-vis des autres communautés. D’accord, il y a des différences culturelles considérables sur cette planète. Mais tous nos pays occidentaux sont déjà « multiculturels », quand ils ne sont pas, comme la Belgique, fait de deux entités différentes. Alors ? Pourquoi conserver cette idée de « nationalité » ? C’est que c’est le fondement de l’État. Sommes-nous libres de renoncer à cette nationalité ? Évidemment non. Sommes-nous libres de changer l’État, de changer d’État ? En théorie, oui, par le droit de vote. Mais dans les faits, nous appartenons à l’État qui nous a vu naitre. Nous ne sommes pas encore tout à fait libres, tout à fait en démocratie, puisque c’est nous qui appartenons à l’État, et non l’inverse. Peut-être sommes-nous des citoyens, mais le terme le plus juste me parait être celui de « ressortissant ». Je suis un ressortissant belge, je sors et ressors de la Belgique, et je ne pourrai jamais qu’en ressortir, à moins d’entrer ailleurs et d’en devenir ressortissant. Pourquoi le voudrais-je ? Parce que la vie serait meilleure ailleurs, pourquoi d’autre voudrait-on s’exiler ?
Bernard Van Breusegem — 22:59
Essayer de bien comprendre la question avant d’essayer d’y répondre. Ne pas aller trop vite. Creuser ce qu’on sait, ses convictions. Essayer de trouver le plus juste biais pour y répondre. Cela nous semble d’autant plus nécessaire qu’on parle de gens, de personnes, d’hommes, de femmes qui vivent des «situations difficiles» (belle figure de style, l’euphémisme), à l’aune de ce qu’on vit. Ces gens, on ne les connaît pas, on ne les fréquente pas, et si on a mis parfois des noms sur des visages, c’est souvent à cause de drames. Ils forment une masse, et en fait, ils font partie d’une classe. C’est ce qui les définit d’abord, avant leur nationalité, leur origine: ils sont manifestement pauvres, et plus pauvres que nous (mais pas pour longtemps, si on perdait notre travail demain).
Et puis l’actualité s’est rappelée à nous: ce matin à la radio, on parlait de 200 sans papier et sans abri qui avaient investi le 133 de la chaussée d’Ixelles pour l’occuper. Selon Belga, «cette action vise à dénoncer le manque de logements pour les sans-abris à Bruxelles et "l’inactivité de la ministre de la politique de migration et d’asile".(…) Les occupants ont rebaptisé le bâtiment qu’ils squattent la "Turtelb’home" et veulent transformer les lieux en un espace citoyen de rencontres et de débat politique.»
On estime à cent mille le nombre d’illégaux chez nous. 1 % de la population.
Et 8531 personnes (selon les chiffres officiels) ont été «éloignées» (merci à l’Office des étrangers pour le choix du vocabulaire). Puisque le débat politique sur la politique d‘accueil n’a, en fait, été suivi d’aucune mesure, quel est le choix laissé à ceux qui veulent régulariser leur situation et qui en auraient peut-être les moyens? À part la grève de la faim, je ne vois pas. Aujourd’hui, nous avons été traîner notre caméra autour du «centre fermé» de Steenokerzeel, le fameux 127 bis, juste à côté d’une piste d’atterrissage, où des avions arrivaient toutes les cinq minutes, ce qui ajoutait une touche sonore très pittoresque, vraiment, un bonheur. À part ça, c’est calme. Très calme. Me revenaient en mémoire les propos de Benassayag sur le post humain, sur la morale qui n’existe pas, quand seule existe l’Éthique. C’est-à-dire qu’absolument, il n’y a pas de bien ou de mal, seulement en situation, dans un contexte précis, et que ça peut changer. Je ne sais pas très bien ce qui change ici.
Stéphane Olivier — 21:33
À moins de considérer Barrack Obama comme un sans-papiers (on pourrait s’y risquer), ce n’est pas ce problème qui fait la une. Pourtant plus de 150 sans-papiers et sans-abri occupent depuis ce matin à 7h30 le rez-de-chaussée d’un bâtiment inoccupé situé au 133 de la chaussée d’Ixelles à Ixelles (un ancien bâtiment Sibelgaz appartenant maintenant à un investisseur privé). «Cette action organisée par l’Union de défense des sans-papiers (UDEP), vise à dénoncer le manque de logements pour les sans-abri à Bruxelles et "l’inactivité de la ministre de la Politique de migration et d’asile" Annemie Turtelboom (Open Vld). L’UDEP réclame une circulaire fixant les critères de régularisation pour les sans-papiers ayant des attaches durables en Belgique. Le bâtiment pourrait abriter 300 personnes, dont une soixantaine d’enfants et de femmes. Les occupants sans-papiers sont majoritairement originaires d’Afrique, du Maghreb et d’Équateur. "Depuis qu’il a pris ses fonctions, le gouvernement tout entier participe à cette inertie et à cette incompétence en ne prenant pas ses responsabilités face à l’un de ses ministres", estime l’UDEP. Les occupants ont rebaptisé le bâtiment qu’ils squattent le "Turtelb’home" et veulent transformer les lieux en un espace citoyen de rencontres et de débat politique.» ce n’était sans doute pas le meilleur jour pour cette action.
Je ne suis pas sûr qu’avec la crise et tout ça, la question des sans- papiers soit encore en haut de la pile.
Vladimir nous a fait remarquer que vendredi, ce serait l’anniversaire de la révolution d’octobre. Curieusement ce soir, sur la deux c’est «Octobre rouge» qui est diffusé, ce n’est sans doute pas en l’honneur de Vladimir Illitch Oulianov qui pourrit lentement dans son mausolée, mais c’est assez ridicule si cette énième rediffusion à été programmée illustrer le duel Obama - McCain. Je me souviens qu’on m’a dit que Jean-Paul Comart joue un petit rôle (le traître?) dans ce blockbuster, lui aussi porte un pseudonyme comme Lénine.
Ce matin on a été faire quelques images au 127bis, le temps était au soleil, et ça nous a semblé une bonne idée d’être un peu concret. Une gentille gendarmette nous a demandé si on filmait le centre fermé, je lui ai répondu qu’on filmait les avions. Je ne pense pas qu’elle m’a cru, mais elle a fait comme si. La volonté de l’état de rendre ce lieu «invisible», alors que ce bâtiment l’est presque déjà complètement (architecturallement et urbanistiquement) m’oblige a admettre que je suis d’accord avec Ronald Reagan quand il a déclaré «L’État n’est pas la solution, il est le problème».
Je suis d’accord avec Ronald Reagan, comme la gendarmette me faisait confiance tout à l’heure. Une même affirmation pour des raisons diamétralement opposée.
Bernard Van Breusegem — 23:52
Des vieux baroudeurs. Voilà ce que nous serions. Le cuir tanné par le vent de quatre créations in a row. Nous dompterions les sujets comme on dompte les chevaux. On serait ridicule.
On essaie de ne pas l’être. L’idée derrière l’opération fait que la surprise de découvrir l’invité est toujours un cadeau. Quand le sujet arrive ensuite, c’est indirectement le commissaire qui se présente à nous. On boit alors le café. C’est Vladimir Léon qui a bu le café avec nous aujourd’hui. Vladimir est un ami de Stéphane. Ils se sont rencontrés il y a longtemps, je pense, dans un festival de cinéma de Tchéquie ou de Slovaquie, quand elles formaient encore un seul pays. Ils étaient encore étudiants et la lecture du monde devait sembler plus simple. En tout cas, il semblait plus clairement dialectique qu’aujourd’hui, le monde. Les idéologies, à l’époque, avaient des uniformes voyants ; aujourd’hui elles se camouflent. Gérard de Sélys nous a proposé aujourd’hui un sujet qui a des implications plus compassionnelles et plus politiques que fictionnelles. Et assez idéologiques, quoi qu’on en dise. Maintenant, nous avons un ministre de la Politique de migration et de l’asile. Le seul problème, c’est qu’il il n’y a toujours pas d’accord gouvernemental abouti sur le sujet. Ça arrange tout le monde. Il y a des problèmes plus important à régler, enfin. On le sait bien, demandez aux banques. En fait la politique d’accueil et d’expulsion que notre pays applique par le truchement de l’office des Etrangers est celle du ministre de l’intérieur Patrick De Waele (open VLD): surtout pas de critères clairs, lisibles, mais une politique de signes à déchiffrer, de signaux vers son électorat sur le dos des sans -papiers, et pour le reste on va bien voir et on verra aux régionales de 2009. Sur son site Anemie Turtelboom, (on ne se moque pas, ce n’est pas bien), la nouvelle ministre de la Politique de migration et de l’asile de 2007, parle trois fois des illégaux qui utilisent votre porte arrière (sic). J’ai eu mal rien que d’y penser. Et je me demande toujours où ils sont open, le VLD.
Stéphane Olivier — 23:42
Ce sujet nous change des quatre précédents ; il est concret et c’est une fiction.
La lecture du sujet m’a tout de suite fait penser à Michel Stree. J’ai repensé à la la prise d’otages de novembre 1980 à Vielsalm – ou Michel Stree et deux de ses copains prennent un bus scolaire en otages et se dirigent vers Bruxelles, afin d’obtenir un temps d’antenne à la RTBF pour dénoncer les injustices sociales. Prise d’otage qui avait fini brutalement, et qui sera «in fine» sans effet.
C’était légitime cette volonté de se faire entendre, c’est toujours légitime. Faire en sorte que chacun soit entendu (pas seulement écouté) est légitime.
Donc la fiction que nous propose Gerard de Selys est un souhait légitime.
«Sans-papiers» est le surnom qu’on donne à un étranger en situation irrégulière.
Une «situation irrégulière» est un statut juridique, qualifiant la situation d’un étranger présent sur le territoire national d’un État, tout en étant dépourvue de titre de séjour en règle. Cette situation peut intervenir de multiples façons: soit après être entré de façon clandestine sur le territoire national, soit pour être demeuré sur le territoire après expiration de la durée de validité du titre de séjour, soit encore, dans le cas d’une personne née de parents immigrés sur le territoire national, parce que la demande de naturalisation n’a pas été effectuée à l’acquisition de la majorité légale. Le caractère illégal de ce séjour, sans permis de séjour en règle, interdit aux étrangers dans cette situation de bénéficier de la plupart des droits, notamment le droit de travailler (d’après Wikipédia).
Maintenant est-ce que de les entendre changera quelque chose…
Cela supposera que ce qu’ils ont a dire n’est pas su, n’est pas connu, n’est pas compris et donc n’a pas sa «place». C’est une vérité, et j’ai grandi avec cette vérité.
Il y a bientôt vingt-ans, peu après avoir rencontré pour la première fois Vladimir Léon dans un drink a Anger. J’ai lu «La Logique du pire » de Clement Rosset qui a changé ma façon de comprendre cette vérité. «…quittez votre ignorance, et vous deviendrez justes et bons. Ah, si seulement on savait! Si le capitaliste savait qu’il exploite une certaine classe sociale! Si le prêtre savait qu’il prêche aux hommes, non l’amour, mais la vengeance! Si le névrosé savait qu’il ne se pardonne pas d’avoir tel désir incestueux! Mais voilà: ils ne savent pas. Disons-leur donc la vérité: ils sauront. On la leur a bien dit. Or, aucun changement ne s’est produit, ni dans la lutte des classes, ni dans l’évolution des idées religieuses, ni dans les manifestations sociales d’interdit sexuel. Que s’est-il donc passé? La réponse est nette: il ne s’est rien passé. Mais pourquoi ne s’est-il rien passé? N’ont-ils donc pas compris? Si, mais apparemment sans bénéfice. S’ils n’ont pas changé, c’est qu’on ne leur a rien appris: tout ce qu’on leur a dit, ils le savaient déjà. Il fallait leur apprendre le parler. Cela, tel ou tel psychanalyste le réussit avec tel ou tel patient.»
Miguel Decleire — 23:22
Pour la première fois, un commissaire nous a proposé un sujet social, politique. Il s’agit de donner la parole, au moins fictivement – afin de le rendre possible réellement, bien sûr – à ceux qu’on appelle les sans-papiers. Pour moi, outre bien sûr le bien-fondé et la pertinence évidents du sujet (ce avec quoi j’imagine que la plupart des gens qui lisent ce blog seront d’ailleurs d’accord) la première question qui se pose pour moi, c’est : Comment donner la parole à quelqu’un – ou à un « groupe » – sans parler en son nom, à sa place ? Comment rendre possible une parole qu’on pressent nécessaire sans la manipuler, la déformer, en faire l’écho de la nôtre, qui voudrions tellement que cette voix soit entendue ? Le risque est toujours énorme de faire pire que bien, et comme dans la scène où Don Quichotte, croisant une colonne de galériens, après avoir demandé à chacun quelle était sa faute, estime que leur châtiment est démesuré, et décide de les libérer ; et ensuite les enjoint, en remerciement, de se rendre les grâces à sa Dulcinée, c’est-à-dire de se conformer à sa vision du monde, de lui payer son bienfait selon ses termes, de lui payer leur liberté en se soumettant à sa loi. Je sens bien les limites de cette comparaison, car si les galériens ont commis effectivement des délits, la question est sujette à caution pour les sans-papiers, mais pour faire court, on pourrait dire que dans les deux cas, la loi les voit comme coupables, et je veux juste mettre l’accent sur le prix de la prise de parole qu’on offre. En fin de compte, pour revenir à la proposition que nous fait Gérard de Sélys, quoi que nous fassions, nous susciterions en définitive une parole que nous mettrions en scène dans un cadre que les « sans-papiers sans-parole » ne maitriseraient pas, qu’ils n’auraient pas choisi. La première question à se poser c’est : Qu’est-ce que j’ai à dire, moi, sur ce sujet, depuis la situation où je suis, avec peu de chances de me retrouver un jour dans la situation d’un sans-papier. Et comment le faire en assumant ce que je dis et la situation d’où je le dis. Ça parait anodin sans doute, et la moindre des choses. Je ne pense pas que ça aille tellement de soi. Nous sommes une civilisation qui s’est érigée sur la culpabilité, et nous n’échappons pas toujours à la tentation de la rédemption, de racheter la faute que nous aurions commise en naissant du côté des trop nantis en nous projetant dans ceux que nous privons, pour nous « sauver » de ce que nous souffrons d’être. Je pense qui si nous voulons la justice, il faut que nous admettions que nous sommes qui et où nous sommes, que nous n’y pouvons rien, et que nous ne pouvons parler que de là. Il est illusoire de nous espérer doués d’ubiquité, que nous puissions à la fois être pauvres et riches, et sur ce plan l’esprit d’universalité occidental a fait, à mon sens, bien du mal en prétendant donner la parole à ceux qui ne l’avaient pas. Comme les missionnaires qui convertissaient les gens contre leur gré mais pour leur plus grand bien, le danger est toujours présent de ne parler qu’en notre nom propre, et de régler par leur entremise nos problèmes avec nos démons.
Tout ceci n’est évidemment pas un rejet du sujet proposé par Gérard de Sélys, mais une première réflexion, méditation, sur la nécessité de rendre nos actes et nos paroles aussi justes que possibles, tant dans le sens de la justice que de la justesse, de l’adéquation à la réalité.
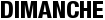
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
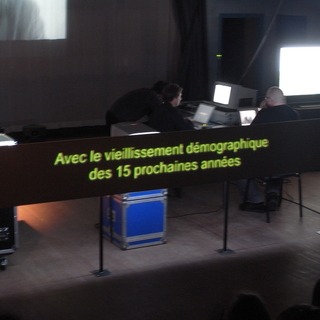
.gif)