Miguel Decleire — 10:39
Il y a une chose qui me préoccupe à chaque présentation, c’est la nature de notre relation avec les commissaires. Leur rôle est plus difficile qu’il n’y parait: nous leur demandons de nous livrer une de leurs préoccupations personnelles. Nul doute qu’ils nous partagent quelque chose qui leur tienne à cœur, qui les touche, qui leur appartienne. Or, nous sommes bien incapables, en si peu de temps, de rentrer complètement dans leur pensée, faute des références adéquates, quelles qu’elles soient d’ailleurs, intellectuelles ou émotionnelles, esthétiques. Bien sûr, nous ne pouvons pas offrir de réponse à leur préoccupation, comment pourrions-nous le faire. Nous pouvons donner une proposition de mise en forme, une façon que nous avons d’interpréter cette question, cette réflexion. C’est évidemment brut de décoffrage, il y a des aspérités, des incompréhensions, des malentendus, des rejets, des désaccords, des agacements, etc. Et puis la proposition que nous faisons est forcément fragmentaire, nous avons nos codes à nous aussi, des choses qui pour nous vont de soi, mais qui ne vont peut-être pas d’elles-mêmes pour des gens qui ne sont pas familiers des salles de spectacle. C’est pour ça que les courts moments où nous avons pu échanger quelques mots avec les commissaires à l’issue des blind dates étaient pour moi si curieux. On se retrouve autour d’une bière, aussi perplexes les uns que les autres, sous le coup de la performance, pas encore délivrés de la vibration publique. Il y a une confrontation, des malentendus, des zones d’ombre énormes. La question que nous avons retourné sous toutes ses coutures pendant une semaine s’incarne tout à coup pour nous dans une personne, elle prend corps, il y a trop de familiarité ou pas assez, et une autre rencontre serait presque à ré-envisager sur ces nouvelles bases. Qui sait? Toutes ces questions qui ont vu leur première floraison, comment vont-elles poursuivre leur chemin par la suite, pour nous comme pour eux? C’est évidemment trop tôt pour le dire, mais ce cheminement souterrain est aussi une partie du projet, et non la moindre.
Et, pour conclure sur tout à fait autre chose, comme beaucoup de gens m’ont demandé ce qui était écrit sur la banderole que j’arborais lors du streaking, je précise qu’il était écrit «België - Belgique». D’autres personnes peut-être n’avaient pas pu le lire.
Bernard Van Breusegem — 23:51
Un vieux sage a dit: «Le billet du samedi bénéficie de plus de recul que les autres, quand le regard et l’esprit se tournent vers le passé, au lieu d’être tendus vers l’avant.» Le vieux sage a tort, il n’y a pas plus de recul, il y a juste plus de repos.
Quatre est un chiffre qui porte malheur pour les chinois et les japonais (il partage avec la mort le même caractère). Or c’était le quatrième blind date. Et comme de toute la semaine, je n’arrivais pas à trouver un chauffagiste qui daigne me rappeler, j’y ai vu un signe. J’avais tort. Parce que vendredi après-midi, un coup de fil de ma compagne m’annonçait que tout était réglé. La vie reprenait des couleurs. L’avenir se dégageait. À 18h, l’espace de jeu était clean, nos consignes aussi et l’équipe pouvait se permettre de se boire une petite bière et de manger des chips avant de commencer. Ce qui allait assez bien avec la question qu’on avait à «traiter»: foot+bière+chips, sortes d’aliments de la pensée post-moderne. Aujourd’hui, reposé, voilà que je n’ai aucune envie de revenir ce qui a été fait. Ite missa est.
Alors faisons plutôt de la prospective: L’endurance va s’avérer être un des pivots de l’opération. Nous le savions, mais ça se confirme. Répéter dix fois le processus n’est pas rien, nous le savions aussi. Et la combinaison rapidité du processus /répétition du processus va produire –outre de la fatigue- des résultats qui risquent d’être radicaux. De plus en plus. La fatigue, si ça peut être handicapant, c’est en tout cas, perturbateur et quand on l’introduit sciemment comme élément d’un processus créatif, 1) faut être taré 2) ça peut donner des résultats inattendus.
Pour ce qui est du spectacle lui-même, il fut –volontairement, en y repensant- sciant, mais je n’en dirai rien d’autre, si ce n’est pour parler du plaisir que nous avons eu à travailler avec Laurence et Nicolas.
Stéphane Olivier — 17:50
Après la présentation d’hier, ce Blind Date nº 4 est, pour moi, celui qui est parvenu à dépassé ce qui dans les 3 premiers restait comme une sorte de lien illustratif avec le sujet. Hier il y avait ce lien, mais aussi quelques moments ou le procédé rhétorique de la métaphore était interrogé. En sus d’être sport et un jeu, le football comme spectacle a développé, si pas un langage, en tout cas des signes et une syntaxe. Signes et syntaxe que nous avons essayé, hier, de traiter comme des post-modernes, ou avec (post)modernité.
Hier soir, on a eu quelque remarque sur la fatigue. Avions-nous l’air fatigué? sans doute. Cette fatigue est est contre productrice, je ne crois pas, elle témoigne d’un travail qui se fait, de résistances qui s’effritent, d’habitudes qui se désagrègent.
Trois semaines de travail continu a ce rythme et avec l’échéance d’une présentation, nous l’avions déjà fait avec «les clubs» il y a quelques années. Mais nous étions dans la quatrième semaine et il y a eu ce changement d’heure, et donc «oui» nous sommes fatiguées. Mais je ne suis pas sur que c’est la seule fatigue qui se voyait, il y a peut- être aussi la fatigue du postmodernisme comme courant culturel esthétique ou idéologique, et la fatigue de la postmodernité comme forme civilisationnelle, ou comme explication du monde.
Ce que dit wikipédia sur l’ère postmoderne (le monde «(post)moderne») est éclairant; «L’ère post-moderne contribue à la fragmentation de l’individu: l’identité se fragilise. Elle se démultiplie ou se compartimente entre des attitudes diverses voire auparavant opposées: «banker le jour, raver le soir» «parfaite maîtresse de maison le soir, business woman le jour»... En fonction des moments de sa vie, l’individu ne se projette plus dans des modèles, mais joue de sa personne à travers plusieurs masques. On tend vers une plus grande flexibilité identitaire: «je est un autre» voire je et plusieurs autres.
Cette fragmentation de l’individu n’est que l’écho de la fragmentation de la société, en de multiples groupes, tribus ou communautés à l’exemple de la culture techno, fragmentation qui se retrouve sur le terrain économique dans l’offre marketing et la publicité et des mass- media, stimulée par le développement d’internet. Cette tendance de fond n’empêche pas le développement de la polyappartenance où un seul individu peut appartenir à plusieurs communautés à la fois, mais à des moments différents de son existence quotidienne. De ces fragmentations résultent non pas la fin de l’histoire, mais la fin des modèles sociologiques patiemment étudiés et conceptualisés. Sous la bannière égotiste du droit d’être absolument soi-même, tous les modes de vie deviennent socialement légitimes. Le modèle patriarcal explose au profit de la juxtaposition de modèles sociaux qui cohabitent créant un sentiment de flottement ou un vieillissement accéléré sur les valeurs de référence et les discours qui en découlent».
Je pense qu’il y avait pour nous un obstacle ontologique entre le sujet que nous proposait Pierre-Olivier Rolin et la possibilité d’en faire une proposition artistique de l’ordre de la représentation; pour nous (architecte ou non) l’art ne peut pas opérer la réification du monde. Nous ne pouvons pas transformer l’abstrait insensé (le monde) en concret signifiant (la performance).
D’une certaine manière Pierre-Olivier Rolin, nous a peut-être fait la proposition suivante; le football n’est-il pas le sport/spectacle qui réussit la réification du monde?
Miguel Decleire — 23:56
Je suis complètement dans le gaz, je crois bien que j’ai attrapé la crève. Je ne mentionne pas ceci pour me plaindre, je regrette bien plutôt de pratiquer si régulièrement le bulletin de santé, mais il me semble que la suite sera plus compréhensible si on sait que je suis en proie aux humeurs – celles qui me dégoulinent du nez. Il faut savoir qu’en plus, je suis en train de récupérer un vieux pc qui a appartenu à ma fille, qui est plein comme un œuf de photos de toutes sortes. Pourquoi s’acharner sur ce vieux presario 700 ? Parce que certains matériels ne fonctionnent que sur pc avec windows, et dans leur grandeur d’âme sont prêts à remonter jusqu’à windows 95. Ça ne nous rajeunit pas. Qui roule encore en windows 95 ? En tant que vieux supporter des logiciels libres, linux et tous les autres gnu, ça me fait un peu mal, mais voilà, parfois (trop souvent), il faut faire avec les choix de ces constructeurs, quoi qu’on en pense. L’avantage d’être habitué aux logiciels libres, c’est qu’on est amené à connaitre les autres systèmes, mac et windows. C’est la force de ceux qui ne parlent pas la langue majoritaire. Ils ont la leur, mais ils connaissent aussi la langue majoritaire, bien sûr, et d’autres, alors que les majoritaires n’en connaissent qu’une seule, la leur, et n’ont aucun soupçon de la diversité qui les environne. Mais passons. Voilà à quoi le notre travail sur le postmoderne et le football nous ont amenés. C’est vrai que le foot, ça a quelque chose d’aussi basiquement, évidemment élémentaire que windows. Les mêmes couleurs criardes, la même innocence stupide d’être au monde. Voilà une réflexion bien postmoderne sans doute. Je rappelle que je suis très enrhumé, qu’il est tard, et donc, j’espère qu’on voudra bien pardonner ces mouvements d’humeur(s) et ces réflexions qui sont, je l’accorde bien volontiers, plutôt d’un niveau de forum d’aficionados. M’en fous, je me lâche. Je revendique mon statut d’aficionado particulariste, je consens au football, j’admets qu’il existe, que les constructeurs produisent leur matériel en se limitant au strict nécessaire – puisque tout le monde, c’est-à-dire 95 % des utilisateurs lambda utilisent windows, soit disant, sans se douter qu’il existe autre chose au monde, mais je revendique le droit d’appartenir à une minorité pour laquelle ces évidences sont des pratiques bien étranges. Oui, je sais, ça a l’air bien prétentieux. Ce qui est différent apparait à ceux qui ne se doutaient pas qu’elle existât (oh !) comme une irruption un peu brutale dans leur monde jusque là bien ordonné, et ils ont sans doute tendance à la prendre comme une provocation, comme si on prétendait à un challenge de leur position dominante. Leur parait-elle tout à coup si fragile, de n’être plus la seule évidence ? Bon, avec tout ça, j’en ai peut-être fait un peu trop, j’ai de loin dépassé les 300 mots pour aujourd’hui. Allez, rendez-vous au match, demain.
Bernard Van Breusegem — 23:23
Echanger les étiquettes, mélanger les tiroirs, redéfinir les classements de manière aléatoire, constater en même le glissement progressif des domaines l’un sur l’autre et d’un vocabulaire vers un autre. C’est ce que l’on a considéré ensemble ces jours-ci. Maintenant nous exécutons l’idée… Sans aucune pitié pour elle, avec quelque chose de froid et de déterminé, de résolu: une idée justement que j’aime bien et qui m’énergise. Ivresse de la vitesse: nous utilisons la pente du mercredi, pour accélérer le jeudi, et percuter le vendredi. Demain c’est vendredi, and we’ve got a date. Comment s’appellent des blind date organisés entre aveugles. Double blinddate? Hier sur mon échelle, en enlevant un truc du grill, des images de footballeur Panini ont resurgi.. Acheter des joueurs, tout ça. J’étais à nouveau agent de mes images. Ce sont nos discussions qui provoquent ce genre d’arrivée, d’emballement où se mélangent nos tiroirs, ces étincelles-là et d’autres, qui ont jailli de la proposition de Laurence d’hier. Elle a dégagé le terrain, et elle nous a montré les fondations. Elle n’est pas architecte pour rien. Depuis, on se retrouve tous encore autour de la table, mais nettement moins. Parce que ous avons tous remonté suffisamment l’élastique pour nous faire avancer. Nous avançons. Chacun s’occupe de son jeu, de ses cartes, les dispose à sa guise pour l’échange final.
Le one shot est décidément une formule formidable. On devrait interdire les séries, une bonne fois pour toutes, parce que les représentations en série, ça s’entasse, ça s’empile, ça moisit, ça s’avachit, et finalement, ça part à rien. Je suis pour la pièce unique. Le seul exemplaire. Une seule trajectoire. Tiens, puisque j’y pense: la lumière des petites lampes à décharge est très belle, il y a quelque chose de gris, d’argenté qui me semble parfait pour ce qu’on va montrer…
Stéphane Olivier — 22:08
Je pense qu’on n’aura pas le temps de répéter demain. Comme si l’optimisation du temps de travail (nos 5 jours) passait par là, et c’est cette répétition là qui est la plus forte, jusqu’ici. C’est avec Laurence et Nicolas, cette semaine de Toussaint, après le changement d’heure que nous avons été les moins stricts sur nos horaires, dépassant 17h, arrivant un peu en retard. Le changement d’heure nous a un peu décalés, je pense.
C’est Benjamin Franklin en 1784, qui le premier a eu l’idée de décaler les horaires afin d’économiser l’énergie. Et c’est, l’Allemagne est la première à instaurer ce changement d’heure, le 30 avril 1916 et est rapidement suivie par les Anglais le 21 mai 1916: le parlement met en place le British standard Time, en avance d’une heure sur l’heure du méridien de Greenwich. L’idée est reprise par l’Irlande et l’Italie, ainsi que par la plupart des pays européens après la guerre. En Allemagne, entre 1947 et 1949, on instaure même un «Hochsommerzeit» où les montres étaient décalées d’une deuxième heure entre le 11 mai et le 29 juin.
D’autres répétitions moins évidentes crée certains déséquilibres, certaines propositions de forme commencent a ce ressembler, et avec celle-ci l’impression de ce répéter. Peut-on utiliser une seconde fois le chatterton blanc pour définir des espaces au sol? Ne devrait-on pas bouger le gradin pour changer? C’est aussi le premier sujet qui a une dimension artistique, ou tout le moins stylistique.
Nous (L, N et nous) ne somme pas préoccupé par notre identité stylistique, ni par la définition de notre époque. Nous y cherchons des chemins comme dans un grand buisson d’argousier sur une dune de sable meuble, mais il n’y a pas un chemin qui nous semble le bon. Je crois qu’il n’y a pas de métaphore pour expliquer notre époque, par ce qu’elle n’a rien de métaphorique.
Stéphane Olivier — 22:47
J’aime le mercredi. Les choses ce sont décanté, on va de l’avant. Aujourd’hui j’aimerai me contenter d’une carte postale: «J’aime le mercredi. Les choses ce sont décanté, on va de l’avant.» comme j’aurai pu écrire, «Beau temps. La mer est bleue, vraiment bleue. Nous partons pour Stroboli demain. Rentrerons le 16 finalement.»
Nous avons trouvé un biais [Moyen de résoudre un problème, issu. Cherchez, inventez, trouvez un biais], pour nous approprier le sujet.
Je pense comme Raymond Queneau, que toute narration serait sur deux formes dramatiques matricielles que l’on retrouve dans «l’Iliade» d’une part et «l’Odyssée» d’autre part. On sait que «L’Odyssée» est le récit d’un long voyage au cours duquel, Ulysse, le héros, affronte maints dangers et aventures, avant de retrouver son foyer, après avoir mûri. Il s’agit d’une sorte de roman d’apprentissage ou de quête initiatique, susceptible d’interprétations diverses ; aussi bien d’un voyage à l’intérieur de soi-même comme le ferait un sujet en psychanalyse, que du passage à la maturité de l’âge adulte ou de la recherche d’une identité. «Zazie dans le métro» est une Odyssée [les derniers mots de Zazie sont «j’ai vieilli»].
Peut-être que nos Blind-date pourront se classer ainsi, Odyssée ou Iliade.
Dans l’Odyssée il y a un héros (Ulysse Odyseus en grec), dans l’Iliade ce sont des stars. Un match de football sera toujours une Iliade (une guerre de Troie), et la vie de Ferenc Puskás sera forcement une Odyssée.
Ce que je pense que j’essaye d’écrire, là. C’est que c’est une question de perspective; quand on est dans le match (dans l’époque), on ne peut raconter l’histoire que comme un Iliade, (une bagarre un peu idiote où s’affrontent des ego (des stars, des joueurs, Ajax, Agamemnon, Achille) en vue de conquérir ou reconquérir une femme Hélène, le ballon, la coupe, etc.) ou l’on gagne finalement toujours par la ruse (le cheval, le dribble de Pelé, la main de Maradona). C’est seulement avec un certain recule qu’on peut distingué l’odyssée qui c’est joué pour Ferenc Puskás.
Bernard Van Breusegem — 22:19
Ce matin, j’ai entendu à la radio une nouvelle qui a éclairé ma journée. Maradona, 48 ans, est de retour! Sélectionneur de l’équipe nationale argentine: tel est le poste où il brillera de nouveau. Dieu n’est pas mort puisque sa main nous revient enfin. N’est-ce point de bon augure pour ce blind date qui porte haut les couleurs du sport sain et des ébats joyeux?
Surtout qu’il me revient à la mémoire un joli texte de P. Desproges sur la coupe du Monde dont je ne peux m’empêcher de citer un extrait: «Voici bientôt quatre longues semaines que les gens normaux, j’entends les gens issus de la norme, avec deux bras et deux jambes pour signifier qu’ils existent, subissent à longueur d’antenne les dégradantes contorsions manchotes des hordes encaleçonnées sudoripares qui se disputent sur gazon l’honneur minuscule d’être champions de la balle au pied. Voilà bien la différence entre le singe et le footballeur. Le premier a trop de mains ou pas assez de pieds pour s’abaisser à jouer au football. Le football. Quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux que le football? Quelle harmonie, quelle élégance l’esthète de base pourrait-il bien découvrir dans les trottinements patauds de vingt-deux handicapés velus qui poussent des balles comme on pousse un étron, en ahanant des râles vulgaires de boeufs éteints. Quel bâtard en rut de quel corniaud branlé oserait manifester publiquement sa libido en s’enlaçant frénétiquement comme ils le font par paquets de huit, à grands coups de pattes grasses et mouillées, en ululant des gutturalités simiesques à choquer un rocker d’usine?(…)» Il faut le dire: Monsieur Desproges portait sur les choses du football le regard perçant d’un arbitre sévère, mais juste, arrivant à garder une neutralité de bon aloi, même quand les contingences l’énervaient un peu, ce que l’on peut comprendre.
Hélas, il nous a quitté trop vite, mais je suis sûr qu’en ce moment attablé dans un bistrot céleste, il discute avec Raymond Goethals des derniers résultats de la ligue des champions. Pouf, pouf.
Aujourd’hui encore, tous ensemble, nous avons aussi beaucoup discuté des derniers résultats de nos réflexions et nous sommes arrivés à ce moment crucial de la pensée que je nomme personnellement «le moment du plombier», c’est-à-dire que cette pensée, on se demande finalement où elle va déboucher. Mais maintenant, le robinet est ouvert, et nous laissons couler avec plaisir, tout en sachant qu’il faut éviter l’eau tiède. Pour terminer, ceci: si le foot est le repaire de toutes les beaufitudes réactionnaires, un certain théâtre peut l’être aussi, quand un autre ne se drape pas artistiquement dans son artitude, arteté, you name it. Mais ce qui me rassure, c’est que, intrinsèquement, par le nombre de gens qu’il implique et la relation qu’il tisse avec eux, et aussi grâce à l’absence de compétition, cette valeur portée au pinacle par le foot et autres sports supports à tous les commerces, le théâtre ne sera jamais aussi puant que le football.
Miguel Decleire — 22:11
Le mercredi est décidément pour moi celui de la tête dans le cul, et je m’excuse d’être à nouveau si scabreux. Je ne comprends pas bien pourquoi. C’est le milieu de la semaine ? Je ne sais pas. C’est le jour où il faut prendre des décisions, où le projet prend forme – ou pas. Peut-être que c’est ça. Mais si c’est mon inquiétude qui ressort, alors celle de nos invités, Laurence et Nicolas, est drôlement plus active. Ce matin, ils sont arrivés (enfin d’abord Laurence) avec toute une série d’idées toutes plus inventives les unes que les autres. Voilà, la présentation est faite, il n’y a plus qu’à les mettre dans l’ordre, et voir celles qu’on parviendra à faire. Ceci clôt donc les débats théoriques autour de la table sur le sujet, celui-ci n’a plus qu’à transpirer de toutes les discussions que nous avons eu, par un effet de percolation accentué par la rapidité du processus. On a décidé qu’il y aura du foot ; il y aura du postmoderne (je pense que nous sommes comme M. Jourdain, nous en faisons sans nous en rendre compte, je crois que c’est de là que vient notre difficulté à la définir, c’est que, comme Puskás, nous sommes le théâtre postmoderne – affirmation éminemment postmoderne et théâtrale à la fois, j’en conviens), il y aura aussi de la métaphore. Mais dans quel ordre, ce sera discutable. Peut-être que le foot sera la métaphore du postmoderne, mais peut-être aussi que le postmoderne sera le foot de la métaphore. Il n’y a au fond qu’un nombre très limité de possibilités avec 3 termes de combinaisons : 1) Foot = métaphore du postmoderne (c’est discutable, mais pourquoi pas) ; 2) Foot = postmoderne de la métaphore (déjà un cran de réflexion au dessus) ; 3) Métaphore = foot du postmoderne (ouaaah) ; 4) Métaphore = postmoderne du foot (là ça me dépasse) ; 5) Postmoderne = métaphore du foot (très fort, vraiment !) ; 6) Postmoderne = foot de la métaphore (ici, on atteint, je crois, le sommet).
Bernard Van Breusegem — 23:43
Aujourd’hui, continuation de l’exploration des relations entre: post-modernisme, post-modernité, spectacle, football, et architecture. Des liens certains existent entre tous ces domaines. Ainsi, pour les deux derniers, il y a en commun des murs, des petits ponts, des grands ponts (qui deviennent des «tunnels» en allemand) et des cages (qui sont des «portes» en allemand). Il y a aussi des surfaces, qu’elles soient ou non de réparation. On en a beaucoup parlé aujourd’hui. Pour ce qui est des lieux post-modernes, Peter Esterhazy dit aussi ceci: «la pissotière est une somme, un des hauts lieux de la sensibilité postmoderne. Une conception, une idée et un esprit commun, plus des effluves d’urine.» Voilà qui est ajusté. Je connais une pissotière post-moderne à plus d’un titre. Elle est accolée à l’Eglise de la place Sainte Catherine, et s’ouvre sur le vismet. Voilà qui est ajusté.
Nous avons découvert aujourd’hui qu’un terrain de foot pourrait être carré, 90 mètres sur 90 mètres par exemple. Mais où sont donc les terrains de football carrés? Pour ce qui est du ballon, il doit être rond, selon les «lois (sic)» du football. Un ballon cylindrique, ce serait postmoderne, hypermoderne, über moderne? Nous n’essayons pas désespérément de le savoir. Notre esprit aujourd’hui s’est levé, s’est déplacé, a roulé vers le plateau comme une balle, a longé le gradin en douceur, a évalué cet espace qui verra se dérouler notre … plan. Puis, à un moment, on est monté sur le terrain, on est aller mouiller un peu notre maillot, pour ajouter au jeu de tête, un début de jeu de jambes (et peut-être parce que notre vestiaire sentait un peu le dromadaire). Demain, mercredi, on s’entraîne, c’est promis.
Stéphane Olivier — 23:43
«… C’est la plus belle métaphore de notre (post)modernité: …» (Métaphore [n. f.] - 1265; lat. d’o. gr. metaphora «transposition» - figure* de rhétorique, et par ext. Procédé de langage qui consiste à employer un terme concret dans un contexte abstrait par substitution analogique, sans qu’il y ait d’élément introduisant formellement une comparaison). Une des conditions de fonctionnement de la métaphore c’est la possibilité de l’analogie. Or mon dégoût du football, depuis hier, me complique un peu la vie. Très concrètement, j’ai du mal a saisir l’analogie que nous a soumise Pierre-Olivier Rolin.
Et hier, en essayant de m’imprégner de cette analogie, je me rends compte en le relisant, j’ai écrit un billet un peu vif…
Cette difficulté, hier me semblait infranchissable…
Dans transquinquennal, c’est nous qui générons nos sujets, ils viennent de nous, directement ou par nos choix. Blind date doit explorer d’autres possibilités, c’est ce qui se passe…
Je ne suis a présent plus sur que le football soit au centre de la métaphore, je pense que c’est plutôt une figure de l’héroïsme. Celle que Péter Esterházy identifie chez Ferenc Puskás: après lui quelque chose est mort, ce qu’il a accompli a terni par anticipation ce qui pouvait être accompli par la suite. (Héros, subst. masc. - Être fabuleux, la plupart du temps d’origine mi-divine, mi-humaine, divinisé après sa mort. - Personnage légendaire auquel la tradition attribue des exploits prodigieux. - Homme, femme qui incarne dans un certain système de valeurs un idéal de force d’âme et d’élévation morale. - Homme, femme qui fait preuve, dans certaines circonstances, d’une grande abnégation).
Si je paraphrase Pierre-Olivier Rolin, il ne s’agit plus alors de football: l’absence de héros est la caractéristique de notre (post)modernité, aujourd’hui il n’y a plus que des stars (Star: Actrice (le plus souvent), acteur célèbre dont l’image auprès du public est celle d’un être fantasmatique, inaccessible, intouchable, entouré de mystère. Professionnel qui jouit d’une grande notoriété, grande figure de la politique, du monde des affaires, toute personne d’exception qui accomplit des exploits et dont l’image est façonnée, consacrée par les médias.)
L’appréhension de Nicolas et Laurence, ressemble à celle de Joseph, il y a deux semaines, la représentation du vendredi n’est pourtant qu’un moment fugace presque intangible. Alors qu’une maison ou un dessin ont une existence concrète, réelle. C’est difficile à comprendre.
Le mardi n’est pas le jour le plus facile.
Miguel Decleire — 22:53
À y regarder de plus près, il n’est pas si sûr que ça que le sujet que nous propose Pierre-Olivier Rollin concerne vraiment la distinction moderne / postmoderne. Sa graphie « (post)moderne » invite à penser qu’on peut envisager notre époque comme l’un ou l’autre, selon l’interprétation de chacun. Tant mieux, parce que pour être franc, cette distinction entre les deux ne me semble pas très porteuse créativement ; ce sont plutôt des choses dont on parle après coup. Je pensais en avoir une certaine idée, mais plus on se penche sur cette distinction, plus on se rend compte que les acceptions sont nombreuses et diverses. Comme si on était encore trop dans le bain pour savoir de quoi on parle vraiment. Ce qui ressort – comment je comprends – de l’analogie proposée avec le football et notre ami Puskás, c’est que notre foutue (post)modernité n’est qu’une période d’application des géniales intuitions qui l’ont précédée. Peut-être qu’on peut voir une analogie avec ce qui nous reste du théâtre élizabéthain – très lointain, et donc plus plastique aux interprétations – méfiance donc. Peut-être que Shakespeare a d’une certaine manière condensé tout ce qui s’était déjà développé à son époque, une sorte de maturité synthétique qui a porté la forme nouvelle du théâtre de son temps à son apogée, d’un seul coup, qui après coup n’a pu que se répéter. C’est un peu le Puskás de son époque, si je comprends bien. Par la suite, il n’a plus été possible que de se mouvoir dans ce qui était créé d’une manière insurpassable. La correspondance vaut ce qu’elle vaut, hein.
C’est peut-être une façon de voir qui a sa pertinence quand on considère les choses a posteriori, une manière d’y voir plus clair dans ce qui nous a précédé, mais je ne suis pas sûr que ce soit très profitable quand on essaye de faire quelque chose de contemporain (au sens littéral). De même qu’il est impossible de faire tabula rasa complètement, il me semble que la réinvention sont susceptibles d’avoir lieu à n’importe quel moment – et précisément en prenant appui sur les décombres du passé. Je sens comme un relent de nostalgie dans les considérations d’Esterházy, et quand on parle d’histoire, je trouve que c’est la pire des choses. À partir de là, il y a deux possibilités : ou bien on s’attache à poursuivre l’histoire de l’art, avec tout le fétichisme que cela implique ; ou bien on cherche dans les contraintes de l’époque (forcément insupportables) celles qui pourront nous faire rebondir dans des directions imprévues. Comme David Lynch au cinéma, par exemple. Avec tout ça, il y a des idées qui ont envie de pointer leur nez. Le football et son rituel, ses surfaces signifiantes, ses dimensions réglementaires, tout ça nous parle dans l’espace qu’on essaye de trouver entre théâtre et architecture. La surface de réparation, par exemple.
Stéphane Olivier — 23:56
Je pourrais commencer ce billet par la déclaration suivante; «Le football est au sport, ce que le chien est a l’animal. Une forme dégénérer qui n’existe que par ce qu’il a valeur de produit de substitution. Le football est un ersatz d’héroïsme, il permet au plus humble de tutoyer les plus grands, et par identification aimer le football c’est à la fois supporter ses héros, intégrer la meute et extérioriser son besoin d’identifier et de détruire son ennemi. Comme le chien, le football moderne a été créé par sélection artificielle, comme lui, il est populaire parce que modelés à la convenance de l’homme»; ou je pourrais simplement énoncé un fait, il m’a fallu trois cafés ce matin et le changement d’heure n’explique pas tout.
Pierre-Olivier Rolin considère comme une parfaite métaphore de ce qui différencie le monde d’aujourd’hui [(post)moderne plutôt que post-moderne] du monde d’hier [moderne] cet extrait du roman de Péter Esterházy. Ferenc Puskás est décrit comme un héros parfait (humain, modeste, sans trace d’égoïsme) qui par ces actes définit le monde, Péter Esterházy l’oppose aux stars, mais surtout a un monde ou les seuls actes qu’il reste à poser seraient des choix. Le texte de Péter Esterházy, et donc le choix de Pierre-Olivier Rolin semble regretté, peut-être avec nostalgie, la modernité d’hier.
Aujourd’hui on a discuté avec Laurence et Nicolas de cette histoire de modernité (quelle que soit sont préfixe), je pense qu’eux et nous somme préoccupé, plutôt par la nécessité de réinterprèter la modernité, (qui serai comme vient de me le confirmer wikipédia «En tant que concept, la modernité est avant tout le projet d’imposer la raison comme norme transcendantale à la société.») plutôt que de s’en distingué a tout prix (par l’adjonction d’un préfixe). Une part importante de la capacité de notre raison étant de faire des contingences («événements fortuits, imprévisibles de l’existence» - ceux sur lesquels on n’a aucune prise - comme les règles de l’urbanisme ou la politique culturelle d’un théâtre ou du pays), des contraintes positives («Effort accompli volontairement sur soi pour modifier un sentiment, un comportement» - en intégrant les contingences au processus créatif, en en faisant les seules limites de celui-ci), espérant sans doute atteindre une certaine transcendance («Transcendance: état de ce ce qui se situe au-delà du domaine considéré; en particulier, ce qui est extérieur à la conscience»), et y parvenant en partie.
En dessous de son sujet, Pierre-Olivier Rolin nous a donné son numéro de téléphone, tout en nous indiquant qu’il n’était pas facile à joindre n’ayant pas de «mains libres ».
Je l’imagine donc en voiture sillonnant son terrain de football, cherchant la passe, l’ouverture.
Bernard Van Breusegem — 23:51
Pourquoi? Comment? Deux questions subsidiaires qui nous sont arrivées avec le sujet de ce matin. P. O. Rollin a été le dénicher, ce sujet, dans un livre de Peter Esterhazy. Ce sujet a aussi les traits d’un joueur de foot hongrois des années cinquante, un joueur dont j’avais déjà entendu parler (chaque sport a des joueurs au panthéon, une mythologie,, et celle du foot dépasse les frontières assez nationalistes qu’il peut parfois entretenir). Bon, je continue à aimer le foot. Pour moi, ça continue d’être un jeu avant d’être un sport et un spectacle. J’aime le football parce qu’on continue à dire, sans trop d’euphémisme, une rencontre de football, et c’est joli comme mot, une rencontre. On dirait que je renifle à nouveau les lignes blanches d’un terrain de foot. J’ai derrière moi une carrière d’une dizaine d’années de football amateur. Back droit. Et la semaine dernière, j’ai regardé la deuxième mi-temps de Rosenborg-Bruges. Entièrement. Ce n’est pas rien. Personnellement, le foot, je le recommande comme jeu, mais pas comme sport. Je lui dois mes petites jambes arquées. Et mon expérience de supporteur n’est très grande non plus: un match de coupe du monde au stade de Bordeaux m’a suffi. Je n’ai jamais été très foule.
Mais voilà, PO Rollin nous fait une passe en profondeur avec ce sujet encore une fois post.
Alors on a exploré aujourd’hui –entre autres- l’architecture (vu que deux transferts de cette discipline ont rejoint l’équipe), et cette idée un peu nostalgique selon laquelle il n’y a plus de génie mais seulement des stars, ou qu’on est plus dans un monde d’invention mais qu’on choisit dans des éléments existants. Je n’en suis pas sûr, personnellement. Je crois que l’originalité a besoin d’une couche épaisse de déjà-vu pour pouvoir éclore. Mais, il faut alimenter cette couche et croire à cette originalité, même si on fait partie de la couche. Et comme la ligue de foot en Belgique a pris le nom d’une bière, je finirai par ceci: si les hommes savent pourquoi, les femmes savent comment.
Miguel Decleire — 23:40
Je ne connais rien au football, je dois bien l’avouer. Enfin, ce n’est pas tout à fait exact. Péter Esterházy a raison de dire, au début de son livre, que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a joué au football. Moi aussi, c’est vrai, suffisamment pour en être dégouté. Je n’ai donc jamais entendu parler de ce mythique Puskás, qui a semble-t-il représenté tant de choses en son temps. En quoi est-il cette métaphore de la (post)modernité ? Plutôt que Cruijff ou Maradona ? Je n’en sais rien, je pense que je ne suis pas à même d’en juger. Quant à la (post)modernité, c’est une de ces choses qu’on croit connaitre, qui représentent vaguement quelque chose quand on en parle de manière plus ou moins entendue, mais qui, lorsqu’on se penche un peu sur ce que ce terme recouvre exactement, prend des formes très diverses. Par exemple, ça veut dire quelque chose de très spécifique pour les architectes, comme nous l’ont appris Nicolas et Laurence, mais ce n’est pas nécessairement ce dont nous parlons nous. Une petite recherche sur wikipedia nous révèle par ailleurs que post-modernisme et postmoderne n’ont même rien à voir, sont même antinomiques sur certains points. Alors quoi ? Sans doute même que ce que Pierre-Olivier Rollin veut dire quand il parle de (post)modernité est encore autre chose, qu’il parle de notre façon de voir les choses comme « après coup », en se référant à ce que nos prédécesseurs modernes avaient voulu lancer comme bouleversements, comme réinvention, redéfinition du monde, et qu’ils nous ont laissé en héritage. Cette façon de se ranger des corbillards des illusions perdues. Le sourire mi-goguenard mi-terrifié de constater que la tabula rasa que nos prédécesseurs modernes se sont échinés à faire est un héritage problématique. Pour l’accepter réellement, il faudrait refaire table rase de cette modernité et reconstruire une nouvelle modernité. Mais peut-on être moderne en suivant consciencieusement les pas de ceux qui voulaient tout réinventer ? Comment résoudre ce paradoxe ? Ils se sont trompés, mais pas complètement, et c’est à nous de démêler tout ça.
Je ne suis pas du tout sûr de ce que j’avance, évidemment, j’élucubre doucement. En fait, à ce stade-ci de la réflexion, ça me rappelle mes années de collège, où nous vivions dans l’ombre de ce que la génération qui nous précédait, celle de 68, avait vécu, ces modèles, ces héros, qui nous avaient laissés, idéalistes mais sans armes contre la normalisation et la restauration dont nous faisions les frais, à retourner leurs armes contre ceux qui, déjà, retournaient leur veste.
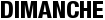
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
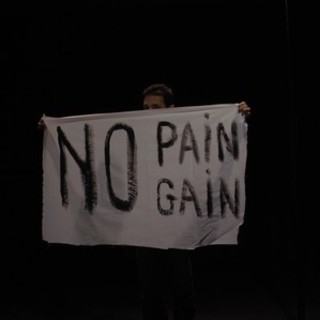
.gif)
J à Bxl — 28/10 10:38
pourtant je croyais que tous les hommes aimaient le foot, la preuve : http://fr.youtube.com/watch?v=6sRcRnef_zc surtout le jeu de jambes me dit mon voisin