Stéphane Olivier — 23:11
Une des choses qu’approchait le spectacle d’hier c’est l’intime, précisément le rapport qu’on entretient avec son désir, ces projets. On voudrait faire ça, on y pense (Freud voulant écrire sur le caractère sexuel de l’architecture). On voudrait qu’une chose soit une autre chose (Freud aurai voulu que le sens de l’architecture soit cohérent avec son explication «du monde»). Et parfois on comprend pourquoi… (Le rêve de Rome).
Comme pour le premier sujet; il y a un parallèle à faire entre le sujet et le projet que nous essayons de mener à bien à travers Blind Date.
Il y a un paragraphe à la fin de «la vie mode d’emploi» que j’aime beaucoup; «C’est le vingt-trois juin mille neuf cent soixante-quinze et il va être huit heures du soir. Assis devant son puzzle, Bartlebooth vient de mourir. Sur le drap de la table, quelque part dans le ciel crépusculaire du quatre cent trente-neuvième puzzle, le trou noir de la seule pièce non encore posée dessine la silhouette presque parfaite d’un X. Mais la pièce que le mort tient entre ses doigts a la forme, depuis longtemps prévisible dans son ironie même, d’un W.»
Qu’est-ce qui est «depuis longtemps prévisible dans son ironie même», L’échec du projet de Bartlebooth (les aquarelles, les puzzles, le tout finalement ramenés à la feuille blanche, au vide)? L’échec de la réalisation définitive du désir?
Cette semaine comme la semaine passée j’ai l’impression d’être passé à côté de quelque chose en n’arrivant pas a entamé une discussion avec le commissaire. Isabelle Berlanger et les frères Lhoas nous on fait un fameux cadeau, en se creusant les méninges pour nous trouvé un sujet qui soit à la fois une de leurs vraies préoccupations, mais aussi en la projetant vers nous (en y ajoutant les explications nécessaires pour Isabelle Berlanger et de l’humour pour les frères Lhoas). Ces délicates attentions ont jusqu’ici profondément influencé notre démarche de la semaine.
Pourtant, hier et vendredi passé, je me suis senti vidée après la représentation. Incapable de mener une discussion sur ce qui venait de se passer. Je me suis senti un peu impoli (surtout quand je parlais de la politesse et de la gentillesse des Japonais), un peu grossier. Pourtant, c’est évidemment dans cette discussion qu’auraient pu naître quelques axes utile à notre questionnement sur le sujet. Cette difficulté, est sans doute la manifestation d’une certaine ironie.
Bernard Van Breusegem — 21:02
Une blind date, deux blind date… Peut-on dire maintenant qu’on a fait une série? Deux, sachant qu’il y en aura dix, ça suffit déjà? La série en art, c’est quelque chose de courant. Je ne parle pas ici du théâtre et des séries, séries de représentations théâtrales, qui n’ont rien à voir: là, en général l’objectif est que les «œuvres» soient toutes absolument identiques, en tendant à reproduire le plus absolument possible ce qui a été représenté 1) lors de la répétition générale, 2) lors de la répétition générale+le rodage de 20 représentations avec du public. Il est vrai qu’on n’a jamais vraiment pratiqué ce genre de sport avec transquinquennal. L’objectif, chez nous est qu’il se passe, si possible, quelque chose de différent chaque soir et si l’on refait parfois, ça nous arrive, c’est par fatigue, par manque, par défaut. Notre mot d’ordre est: «si possible de l’audace, et c’est toujours possible». Mais ceux qui nous suivent savent bien cela. Non, par série, j’entends bien: «un ensemble ordonné d’œuvres régies par un thème, support d’un problème plastique à résoudre, soit une multiplicité de figures plus ou moins équivalentes résultant d’un jeu combinatoire ou encore d’un traitement répétitif systématique». (Encyclopédie Universalis)
D’accord, au sens strict du terme, nos problèmes ne sont pas plastiques, mais leur ensemble est bien régi par un thème fondamental et sous-jacent, et nous cherchons bien une résolution aux questions, «mais les figures ne sont pas équivalentes» et on me citera Roman Opalka, par exemple, où Andy Warhol et on aura raison. Bon, à contre-cœur, j’abandonne là, pour le moment, mon idée de série, mais j’ y reviendrai, parce que c’est gratifiant. Disons ceci: les blind date sont à la fois une technique et un processus qui importent autant que le résultat, ils en sont aussi le résultat. Pour reparler de ce qu’on a fait hier en compagnie de Joseph Falzon, et pour rembobiner un peu le film, j’espère que Joseph ne m’en voudra pas si je révèle ici ce qu’il m’a dit au bar du Varia hier soir vers minuit, à savoir qu’il était si nerveux dimanche dernier à l’idée de travailler avec nous qu’il n’en avait presque pas dormi de la nuit. Mais que dès lundi, tout s’était passé le plus naturellement du monde. Merci Joseph. Pour ce qui est du résultat, je n’en dirai rien. Simplement que le résultat aurait pu être accompagné de ce carton explicatif: Falzon-Transquinquennal: techniques mixtes.
Miguel Decleire — 19:01
Pour des raisons pratiques, il se fait que je suis le seul à avoir pu assister à la présentation d’hier soir. Et assister vraiment en tant que spectateur, parce que mon rôle de « gardien » me donnait un point de vue privilégié, vu que je n’avais rien d’autre à faire que de veiller à ce que tout se passe correctement, muséalement parlant, et d’ouvrir la porte à la fin pour inviter le spectateur à laisser la place au groupe suivant. Les trois autres, malheureusement, étaient cachés, et n’ont même pas pu suivre les évènements sur moniteur parce que Bernard avait besoin de vérifier en direct, par un coin du rideau, l’état réel de la lumière, et que le moniteur projetait trop de lumière. On s’était dit qu’on aurait le temps de faire une répétition, mais finalement, non. C’est donc le récit de l’unique spectateur que je devrais faire, mais ça n’a pas grand sens, évidemment. Ce qui m’a paru très singulier, tout de même, c’est la différence de positionnement des groupes dans l’espace : l’un a pris directement les feuilles et s’est alignés de ce côté-là, avec une belle discipline spontanée ; les autres groupes se sont disposés du côté où étaient les gradins la semaine précédente, ils s’attendaient sans doute à plus de théâtre, mais comment savaient-ils que le gradin était de ce côté-là ? Curieux. J’essaye de me représenter la frustration de Joseph, qui, il me l’a confié après, éprouvait le trac du théâtre pour la première fois, et qui n’a pas pu profiter de la présentation elle-même pour le dissiper. Au démontage de la maquette, pourtant, il s’en est donné à cœur joie.
L’après-spectacle commence à trouver sa formule, et s’est passé plutôt bien hier soir il me semble, mais on aurait pu être plus clairs, et je pense qu’on pourra l’être encore plus pour la blind date de la semaine prochaine. Le travail de celle-ci a été très agréable, une très fluide élaboration du projet avec Joseph qui craignait pourtant d’avoir des difficultés à s’intégrer dans un travail collectif. C’était très intéressant d’imaginer à quatre une dramaturgie « statique », et en trois dimensions, à la jonction de nos deux pratiques, et même des trois convoquées, la bande dessinée, le théâtre et l’architecture. Évidemment, nous avons sans doute été aidés par le fait que le sujet du commissaire et la pratique de l’invité se combinent facilement.
Miguel Decleire — 23:58
Aujourd’hui, c’était mon tour d’arriver en retard. Le rond-point Schuman, par où je passe tous les jours pour aller de chez moi au studio du Varia, était bloqué pour le sommet européen qui se déroulait au Justus Lipsius (on garde la graphie latine pour éviter de devoir dire : « just lips » ; ah, on parle de sexualité et d’architecture ou pas ?). Impossible de traverser le rond-point, il fallait contourner. Je suis revenu sur mes pas, et je me suis retrouvé au parc du Cinquantenaire, en face de la grande mosquée et un peu plus loin, du pavillon des passions humaines, condamné par son imposant voisin à rester hermétiquement clos. Je me suis dit que cette déviation me conduisait au cœur notre sujet avec ce bâtiment dont la vocation si particulière, le rêve, l’évocation d’une possible volupté collective, le conduisait par cela même à rester fermé (et les autorités de la mosquée n’ont fait qu’emboiter le pas aux responsables puritains des musées qui les ont précédés...). L’architecture ne peut évoquer la sexualité, du moins trop explicitement. Pourtant le pavillon reste là, on aurait pu le détruire (ah non, on ne démolit pas du Horta), ou le démonter et le remonter ailleurs, mais non. On dirait que sa raison d’être est de se montrer ostensiblement fermé, inaccessible. Mais ce n’est pas le seul. La mosquée voisine, par exemple, ne s’ouvre pas à n’importe qui, seuls les fidèles sont admis. Le rond-point non plus, le Juste Lipse et les autres n’étaient pas plus accessibles au « non-Européens ». Il m’a semblé d’un seul coup que ça faisait beaucoup d’ostentation pour le déni d’accès. Que ce soit les bâtiments européens, avec leur pompe en fer-blanc et leurs services de sécurité perfectionnés, ou les bâtiments religieux avec leur ventre gigantesque tendu vers le ciel, ils ne sont si magnifiques que pour montrer à tous que leur accès n’est réservé qu’à quelques uns, les « élus » (d’une manière ou d’une autre, ou d’une autre encore...). C’est le propre de l’architecture du pouvoir de montrer aussi ostensiblement une porte fermée. Elle assoit sa séduction par la frustration, c’est le principe des stars, inaccessibles étoiles. Le caractère sexuel évident de l’architecture, qui vient de l’entrer/sortir, est aussi manifeste, si pas plus, quand la pénétration est déniée. Et ce principe a l’air assez général : en passant devant le Colruyt de la rue Gray, c’était de nouveau la même ambivalence : le panneau lumineux affichait « free » au-dessus de la barrière fermée. Décidément, le seul bâtiment qui s’affiche comme ouvert dans le quartier, c’est la friterie de la place Jourdan. D’un rectangle, c’est devenu un octogone. Mais là aussi, ça sent l’arnaque, parce qu’à force de s’agrandir pour accueillir toujours plus de clients, la qualité des frites a baissé. Chacun sait qu’aujourd’hui, pour trouver les meilleures frites, il faut continuer tout droit la rue Gray, jusqu’à la place Flagey (célèbre par ailleurs pour le passionnant feuilleton de sa rénovation). Là, pas d’ostentation, pas de clin d’œil aguicheur au chaland. Une baraque à frites qui ne se veut pas autre chose qu’une baraque à frites, des patrons revêches, mais le temps d’attente est proportionnel à la croustillance des frites et à leur moelleux. La graisse est propre, et la béarnaise maison remarquable, bref ce sont les meilleures. Et si on peut relier le principe de plaisir à la sexualité, alors on reste au cœur du sujet.
Bernard Van Breusegem — 23:38
lLe 13 octobre 1885, Freud a commencé à fréquenter le service du professeur Charcot à la Salpêtrière. Le 13 octobre est tombé un mardi, cette année-là. Freud avait un projet de recherche en anatomie, pour lequel il avait obtenu une bourse (Charcot avait mis au point une méthode de recherche appliquée à l’anatomie cérébrale, puis étendue aux névroses dont l’hystérie, envisagée comme un chapitre de la neuropathologie). S. Freud s’installe donc à Paris à l’hôtel du Brésil, rue le Goff, n°10, dans le cinquième arrondissement. Il y a un peu plus de vingt ans, j’ai travaillé dans cet hôtel, comme réceptionniste de nuit. Il y avait une plaque sur la façade rappelant son séjour. J’en suis parti après que le patron corse (qui me payait très mal et en noir), m’ait réclamé le remboursement de la note de téléphone que j’avais oublié de facturer à un Allemand. Pendant un moment, il a continué à m’appeler pour que je lui rembourse cet argent, m’accusant de l’avoir volé. Puis j’en ai eu assez et je l’ai menacé de le dénoncer au Ministère du travail, ou quelque chose comme ça. Cet oubli, évidemment, ça devait être un acte manqué. C’est ce que je me plais à croire. Mais c’est de la psychanalyse à cent balles, à peu près le montant de la note impayée de l’allemand. Si une chose en dissimule une autre, le problème est toujours de savoir si l’explication de cette chose ne demande pas à son tour une explication. Plus loin, on aime les solutions simples, mais raisonnablement, il y a-t-il des solutions simples à des problèmes complexes? Les problèmes qui nous occupent pour ce Blind date n°2 ne sont pas si complexes. On recrée le monde en cinq jours, et on doit toujours se le redire que ce format, nous l’avons choisi parce que justement, il ne permet pas certaines choses, mais il en autorise d’autres. C’est une sorte d’espace pulsionnel, et le sens qui en émerge nous dépasse -comme toujours naturellement- mais d’autant plus ici. Vendredi dernier, il ya des choses que je voyais et qui m’étonnaient, qui m’émouvaient parce que je me disais: mais en fait ça veut dire ça! Du sens apparaissait pour moi, du sens indirect en direct, et pas du sens tellement voulu, tellement mis en forme qu’il s’appauvrit et qu’il appauvrit le reste: la représentation n’était plus que le médium qu’elle doit être et elle retrouvait pour moi son sens premier. Pour ce qui est de ce qu’on va faire demain, il est bien trop tôt pour dire si on arrivera à quelque chose de semblable, mais laissez-moi vous dire qu’on fait tout pour ça, consciemment en tout cas.
Stéphane Olivier — 21:00
Bernard notait hier dans son carnet: «Dans quelle langue rêve-t-on?». Je ne sais pas. En fait je doute qu’on rêve, je pense même qu’on ne rêve pas. En tout cas pas dans le sens où nous l’entendons. Pendant notre sommeil, un processus biologique (chimique, électrique…) nous secoue l’intérieur. À notre réveil, il faut donner un sens, une apparence de significations, de cohérence (d’ordre linéaire) au trouble que nous ressentons. Et c’est à ce moment que notre inconscient va chercher des schémas, des mots, des situations qui tentent d’atténuer la terreur que provoque ce remue-méninges, ce moment insensé où nous avons perdu toute conscience, ou nous nous échappons.
Lionel Naccache dans «Le nouvel Inconscient» (Odile Jacob, 2006) décrit le phénomène suivant ; quand quelqu’un que nous attendons, n’arrive pas, est en retard à notre rendez-vous, in petto, nous construisons une interprétation fictionnelle qui donne un sens à ce retard, «il y a un sommet européen, son bus a dû être détourné», «il était fatigué hier ; il a dû avoir du mal à se lever ; etc.». L’insensé "ce retard ne prendra des significations que quand mon rendez-vous me l’expliquera" nous ne nous le disons jamais spontanément, il est inacceptable à notre conscient.
Le rêve fonctionne un peu de la même façon, a mon avis. Mais même comme ça, il peut rester la voie royale qui mène à l’inconscient. Quand on rêve (quand réveiller on donne un sens à l’insensé), notre interprétation de la trace de mécanismes biologique donne autant de renseignements sur notre inconscient que si au cours de la nuit cette fiction c’était donnée en représentation dans notre esprit. La seule différence c’est qu’il faut arriver à accepter qu’il y a un moment chaque jour auquel on ne peut pas donner de sens, un moment ou on n’est pas. Pour moi ce qu’on appelle rêve (quand on dit j’ai rêvé) prend une tout autre valeur si on considère qu’il s’est créé alors que nous étions réveiller. Il perd toute son omnipotence, sa majesté, son incontestabilité. Il est désarmé.
Ce qui me fait le plus peur, ce n’est pas l’insignifiance, c’est le tout signifiant. Le tout signifiant à pour conséquences qu’on met trop souvent la raison, le raisonnement sur le côté, pour faire place à la croyance, qui donne un sens sans raison en échange. Les limites de la raison ne doivent pas délimiter les frontières de la croyance.
Comme j’aime me convaincre que chaque jour, durant un certain temps «je ne suis plus», je disparais, je perds tout sentiment (frauduleux) d’une existence individuelle, pour me plonger avec délice dans l’insignifiance d’une existence biologique, atomique, particulaire.
Bernard Van Breusegem — 23:38
Pour écrire le mot du soir, je m’appuie parfois sur des notes éparses prises au cours de la journée, mais pas toujours. Je les utilise moins comme un point de départ que comme une façon d’étayer ma pensée et mes sentiments au moment de les traduire, de les rationaliser en quelque sorte, en tout cas d’utiliser une autre langue que celle de l’origine. Tout à l’heure, j’ai noté dans mon carnet ceci à propos du travail d’aujourd’hui: «dans quelle langue rêve-t-on?». Je ne sais pas pourquoi j’ai noté ça. Je ne sais pas du tout. C’est une question subsidiaire qui m’est arrivée de je ne sais où, amenée par je ne sais quoi, disons peut-être le contexte général freudien dans lequel nous baignons depuis lundi. C’est une réponse qui ne me satisfait pas mais qui est suffisamment simple pour que je l’accepte. Je crois savoir qu’on rêve dans sa propre langue, et que quand on en connaît suffisamment une autre, ou d’autres, ou encore qu’on vit dans un autre pays depuis assez longtemps, on finit par rêver dans une autre langue que la sienne. Explorant cette question une fois rentré à la maison, je suis tombé par hasard - mais depuis un certain temps, je commence à croire de moins en moins au hasard– sur un texte que Jacques Derrida a écrit et lu lorsque la ville de Francfort lui a remis le prix «Theodor-W.-Adorno». Je voudrais simplement en citer quelques extraits, et que je sois excusé de réduire ainsi sa pensée: «(…) Rêve-t-on toujours dans son lit, et la nuit? Est-on responsable de ses rêves? Peut-on en répondre? (…) Entre rêver et croire qu’on rêve, quelle est la différence? Et d’abord qui a le droit de poser cette question? Est-ce le rêveur plongé dans l’expérience de sa nuit ou le rêveur à son réveil? Un rêveur saurait-il d’ailleurs parler de son rêve sans se réveiller? Saurait-il nommer le rêve en général? Saurait-il l’analyser de façon juste et même se servir du mot «rêve» à bon escient sans interrompre et trahir, oui, trahir le sommeil?
J’imagine ici deux réponses. Celle du philosophe serait fermement «non»: on ne peut tenir un discours sérieux et responsable sur le rêve, personne ne saurait même raconter un rêve sans s’éveiller. (…) Ce «non» lie la responsabilité du philosophe à l’impératif rationnel de la veille, du moi souverain, de la conscience vigilante. Qu’est-ce que la philosophie, pour le philosophe? L’éveil et le réveil. Tout autre, mais non moins responsable, serait peut-être la réponse du poète, de l’écrivain ou de l’essayiste, du musicien, du peintre, du scénariste de théâtre ou de cinéma. Voire du psychanalyste. Ils ne diraient pas non mais oui, peut-être, parfois. Ils diraient oui, peut-être parfois. Ils acquiesceraient à l’événement, à son exceptionnelle singularité: oui, peut-être peut-on croire et avouer qu’on rêve sans se réveiller ; oui, il n’est pas impossible, parfois, de dire, en dormant, les yeux fermés ou grand ouverts, quelque chose comme une vérité du rêve, un sens et une raison du rêve qui mérite de ne pas sombrer dans la nuit du néant.(…)»
En relisant cet extrait et à la suite, l’ensemble, je m’aperçois qu’il faudrait, pour bien faire, mettre ici tout ce texte qui fait 9 pages, et que c’est impossible. Comme en plus ça n’a pas trop de sens de conclure quoi que ce soit à la suite de Derrida, je vais terminer par ce dialogue que j’ai capté au vol tout à l’heure et qui se déroule entre Stéphane et Miguel. Il pour moi est plein de sens même si je suis incapable de préciser lequel:
-Stéphane: il est quelle heure?
-Miguel: il est déjà quatre heures.
-Stéphane: c’est ça.
Miguel Decleire — 21:27
J’aimerais parler concrètement de ce que nous sommes en train de faire, de l’état d’avancement du projet, des questions que nous avons, mais c’est difficile sans dévoiler complètement la « surprise ». Mais ce que je peux dire, c’est que aujourd’hui, la question, c’est surtout une question de temps. On n’aura pas le temps de faire tout ce qu’on projetait. Il était prévu qu’on présente quelque chose d’inachevé. Il le sera plus que prévu, sans doute. Ce n’est pas nécessairement grave, mais la question devient, comment tenir compte de l’inachèvement de ce qu’on fait au moment où on le fait. On fait les choses différemment si on sait qu’on n’aura pas le temps de les finir, parce qu’elles doivent porter l’essentiel de ce qu’on veut dire en elles-mêmes.
Je sens que nous avançons aussi, parce que c’est une question que nous nous sommes posée la semaine passée le jeudi. Le mercredi nous avions conçu le projet, et le jeudi nous l’avons réalisé dans les grandes lignes. Nous avons gagné un jour cette semaine-ci. J’imagine que ça va être la question du mercredi, pour les autres blind dates aussi. Le jeudi ça va être : qu’est-ce qu’on abandonne, et le vendredi, c’est la régie – comment les gens entrent, la conduite lumière, etc. Chaque jour aura ainsi sa dramaturgie, le lundi, la rencontre, le jour du clash et des premières impressions, les recherches et les premières pistes ; le mardi, la conception et l’ébauche du projet, etc.
Pour revenir plus concrètement à nos moutons, la tension dans laquelle je me retrouve, et qui est sans doute plus vive dans ces blind dates, c’est de savoir si ce que nous essayons de faire va rendre compte de notre intention. Il y a toujours un moment délicat où on est parti dans la réalisation du projet, mais les questions qui se posent sont des questions techniques. On doit faire des choix, et on se rend compte qu’il y a des choses qui ne sortiront pas comme on les a rêvées. Ce n’est pas grave en soi, mais la question est de savoir si le projet en sera dénaturé ou pas ? C’est peut-être tout bêtement une question de confiance en soi, mais je pense que le « style », c’est-à-dire la réalisation technique et comment elle est assumée, sont le véhicule essentiel de ce qu’on essaye de transmettre. C’est une première sensation, qui infléchit donne le cadre de référence à tout ce que se passera après. On dirait que je suis inquiet, mais en fait pas du tout. C’est juste la préoccupation du jour. Jusqu’où est-ce que j’inscris l’inachèvement dans ce que je réalise. Est-ce que les détails ne masquent pas l’ensemble.
Stéphane Olivier — 21:19
Quand Freud abandonne l’idée d’écrire un essai sur le caractère sexuel de l’architecture antique, en mai 1904; il n’est ni en Italie, ni en Grèce, il est de retour à Vienne. C’est donc son souvenir de l’architecture antique qui n’est pas à la hauteur de son projet.
Mon premier souvenir d’architecture, ou plutôt le premier que j’associe à l’architecture m’est revenu très souvent à l’esprit ces derniers jours.
Une voix, une musique et un long travelling avant «Une fois de plus -, je m’avance, une fois de plus, le long de ces couloirs, à travers ces salons, ces galeries, dans cette construction - d’un autre siècle, cet hôtel immense, luxueux, baroque, - lugubre, où des couloirs interminables. succèdent aux couloirs, - silencieux, désert, surchargé d’un décor sombre et froid de boiseries, de stuc, de panneaux moulurés, marbres; glaces noires, tableaux aux teintes noires, colonnes, lourdes tentures, - encadrements sculptés des portes, enfilades de portes, de galeries, - de couloirs transversaux, qui débouchent à leur tour sur des salons déserts, des salons surchargés d’une ornementation d’un autre siècle, des salles silencieuses...» (in «L’année dernière a Marienbad», Alain Robbe-Grillet).
Un souvenir qui est comme un rêve. On sait que Freud dans «L’interprétation des rêves» se réfère a un rêve qu’il à fait de Rome, qui pourtant a ces murs couvert d’affiche en allemand qui en fait n’est pas Rome mais Prague la ville ou Freud devait rencontrer un amis quand il était nationaliste allemand, et pour Freud les deux désirs se serai confondu, ou associer. C’est n’est pas le passage qui m’a le plus convaincu. Sans doute par ce que pour moi l’antiquité n’est pas un objet de désir. Je n’ai jamais été à Rome et le Rome de Nanni Moretti, de Felini ou du «Ventre de l’architecte» est un Rome qui me suffit.
Mais comme Freud, et comme vous peu-être je fais depuis très longtemps un rêve ou l’élément principal est architectural. Je rêve d’une maison blanchâtre, à la nuit tombante ou tombée, parfois avec un vieux réverbère au sommet d’un poteau qui sent le créosote. Un toit sombre et parfois des fenêtres, mais pas toujours. Et une porte. L’espace intérieur est plus grand que l’espace extérieur. Il y a une sorte de piscine en carreau blanc, un peu comme à la source de Spa. Il y a longtemps, elle était pleine, maintenant quand je fais ce rêve elle est presque vide. Ces habitants l’ont déserté peu à peu. Je me souviens y avoir nagé avec beaucoup de mes amis il y a à peu près 25 ans, on riait, on sautait, on plongeait, on faisait les fous…=
Bernard Van Breusegem — 23:33
Je ne sais pas quelle tapisserie de Bayeux on est en train de tisser, j’ai de furieux doutes sur la linéarité de ce qui nous occupe et je commence à hésiter sur le sens dans lequel on est sensé lire l’ensemble. Surtout après notre voyage au Japon, et après les réflexions de notre ami D.L. de G sur notre blog. Mais du calme, et comme disait Francis Fukuyama, ceci est une autre histoire. Après quelques recherches pour trouver le livre dont était extraite la citation qui a servi de référence au duo architectural L&L, Ecaterina nous l’a apporté ce matin ce livre. En voici le titre: «Sigmund Freud. Correspondance de voyage 1895-1923». C’est publié chez Fayard avec une préface d’Elisabeth Rudinesco. Jusque-là tout va bien, on est en terrain connu, et même, rassurant. Voilà, on a trouvé, ce serait une bonne pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt basée sur une idée de Yasmina Resza, ou l’inverse. Une pièce bien, bien faite. Et forcément, ça marcherait bien, bien. Devant la pression du succès, on passerait dans la grande salle du Varia, obligés, puis au théâtre St Michel, flattés, puis en tournée, fatigués, ensuite une star française lirait la pièce, en achèterait les droits, en ferait un film, dont les Américains achèteraient les droits pour en faire un film, etc. Et l’on prendrait une retraite bien méritée, du côté de Genval, ou de Loverval, ou Vitrival, enfin, je ne sais pas, des noms en val. Mais, serait-ce vraiment satisfaisant? En fait oui. Je pourrais enfin m’offrir à plein temps les services du professeur Loayza. Ça m’apporterait la crédibilité que je n’ai pas. Ce n’est pas à négliger. Mais arrêtons de fantasmer, ce Loayza nous est bien trop cher, il est même carrément hors de prix. Oui je me laisse aller, mais j’ai le droit. Je le prends. Je suis ma pulsion, manquerait plus que Ça …Je suis quand même celui à qui le traducteur français du «mot d’esprit et sa relation à l’inconscient» de S.Freud. a offert son livre avec cette dédicace: «bien cordialement». Oui, il y a le stade oral, anal, et enfin cordial, et ce n’est pas le moins bon.
Pour en revenir notre question, ce livre est affolant. On y apprend des choses difficiles à croire dont on devrait parler vendredi, si on ose: Sigmund était un vrai polisson, il prenait de la coke, et pire, il fumait. C’est dégueulasse de fumer, surtout que depuis lui, on sait ce que ça remplace, symboliquement parlant. La coke, mon dieu, c’est une drogue d’adulte, ou de trader, et puis coca-cola en fait la pub, … mais le cigare, il faut vraiment être vicieux, et ce n’est pas notre ami G.D. de S. qui nous démentira. Rien que d’y penser, j’en ai des hauts-le–cœur, faut vraiment que j’y aille …
Stéphane Olivier — 22:45
Ce matin, en allant chercher de l’argent, devant moi un homme d’un certain âge en engueulait un autre, au titre que lui ayant un travail devrait avoir priorité sur l’autre qui chômeur avait tout le temps pour aller a sa banque.
Je me suis un peu énervé contre ce discriminateur et j’ai laissé l’automate garder ma carte.
Ce soir en allant récupérer ma carte a la banque; pendant que j’expliquais à l’employé que le coût annuel du chômage est d’environ 6, 4 milliards d’euros par an, à peu près ce que le gouvernement vient de donné a ma banque et que je n’avais pas l’impression que malgré ce coût équivalent les banquiers était aussi mal considéré que les chômeurs, je me suis demandé: a quel moment d’une crise économique mondial est-ce que j’aurai l’impression que l’argent des subventions d’état qui finance notre travail est une obscénité.
Les arts de la scène en communauté française c’est 79.958.000 €, soit 1, 24% des 6.400.000.000 €. Beaucoup plus que je ne l’imaginais en cherchant ces chiffres.
Obscénité: «qui offense le bon goût, qui est choquant par son caractère inconvenant, son manque de pudeur, sa trivialité, sa crudité.»
Tout ça se mélange un peu. Dire que l’architecture à un caractère sexuelle n’est pas tout, on peu supposé que ce caractère peut être positif on négatif, sexy ou obscène, éros ou thanatos. Quand est-elle une offense au bon goût; choquante par son caractère inconvenant, son manque de pudeur, sa trivialité, sa crudité et quand est-elle sexy, excitante, voluptueuse, affriolante sensuelle séduisante, érotique.
Il y a des bâtiments que je trouve obscènes à Bruxelles, l’immeuble de la KBC près du canal, le caprice des dieux, les nouveaux bâtiments près de la gare du midi (ceux devant lesquels se trouve la place Marcel Broothaers), et je ne fais pas preuve d’originalité.
Est-ce que dans mille ans un Freud ayant rêvé de l’architecture bancaire et institutionnelle de l’ancienne Bruxelles, arriver place du Luxembourg laissera de côté son projet d’écrire un essai sur le caractère sexuel de celle-ci. Comme Freud, il y a cent ans devant Athènes se rappelait que tout cela avait été bâti sur une société esclavagiste, et qu’il se souvenait à Rome du prix de l’impérialisme.
Parce que la vraie question a posé à un architecte c’est: «Que feriez-vous comme architecture pour que Freud n’abandonne pas son projet d’écrire sur son caractère sexuelle».
Miguel Decleire — 21:40
Toujours sur les traces de Sigmund Freud en Méditerranée. Ce petit polisson nous joue des chausse-trappes. Le livre que nous attendions hier ne nous a pas beaucoup plus éclairé sur les raisons de son désintérêt pour l’essai qu’il projetait. Il renvoie à un autre livre, qui sans doute nous renverra à un autre encore. Tant pis. Dieu seul sait ce qu’il avait en tête. Il a peut-être simplement oublié.
Il parait qu’il aurait donné raison à Goethe qui disait: «Le Nord est une erreur.» Dire que cet énergumène, lycéen, tenait un journal en grec ancien. Comme Freud avait rêvé les cités antiques, nous rêvons Freud. Après tout, nous en avons bien le droit, et il l’a bien mérité. La structure du projet se dessine petit à petit, et nous avançons à grand pas. Disons que nous en sommes au gros-œuvre. Le travail avec Joseph est décidément très agréable, et il me semble – peut-être me détrompera-t-il – que nous avançons réellement à quatre, avec une fluidité étonnante.
Le caractère sexuel de l’architecture tient probablement à ce que nous pouvons sans cesse la réinventer, de l’intérieur comme de l’extérieur. Nous pouvons la contenir en nous, et rêver d’être contenus par elle. C’est une mise en scène permanente, sans drame, ce qui veut dire qu’on peut aussi la pratiquer quand on a envie de ne rien faire de particulier. On pourrait tout rêver une ville simplement pour dormir sur un de ses bancs. Et qui sait, rêver le rêve de quelqu’un d’autre. Comme l’ami Sigmund d’ailleurs, qui s’est mêlé des rêves des autres aussi, notamment un certain Wilhelm Jensen, qui a suivi une jolie Romaine de bas-relief dans ses pérégrinations immobiles au point de s’y perdre. Il l’a appelée la Gradiva, et bien d’autres l’ont suivi, jusqu’à Robbe-Grillet tout récemment, grand amateur de labyrinthes et de temps suspendus. Mais Freud a été le premier, et il a préféré psychanalyser le héros de son roman que son auteur.
Mais nous, nous agençons des blocs, des boites, des formes, et nous imaginons de quoi elles seront pleines. Ou vides.
Stéphane Olivier — 23:35
Ce matin Joseph est arrivé avec un peu d’avance au studio. Heureusement, j’étais déjà là pour essayer de régler les problèmes de webcam. On ne connaissait pas du tout Joseph Falzon avant de penser au projet BD. La BD c’est un peu loin pour nous trois, même si on en lit, j’en achetais beaucoup dans le temps. Mais quand on a imaginé BD on a pensé qu’un dessinateur sera un bon invité, et on a fait des recherches, puis un choix. Les frères Lhoas c’est plutôt une évidence, on était sur qu’ils fassent partie du choix de l’un ou l’autre go betweens et ça a été le cas.
Le sujet à l’air simple en apparence ("En mai de cette année-là [1904], il [Freud] projetait d’écrire un essai sur le "caractère sexuel de l’architecture antique", mais ce projet ne vit finalement pas le jour". In "Notre coeur tend vers le sud ", p.167.... Et son actualisation!). Où est Freud en 1904? Quel est le caractère sexuel de l’architecture antique? Pourquoi ce projet ne vit-il pas le jour? Et l’actualisation… de quoi? Du projet qui finalement aura été réalisé plus tard par Anna? Plus probablement du caractère sexuel de l’architecture.
Dans mon Dictionnaire de la Psychanalyse (Laplanche et Pontalis) il n’y a pas d’entrée à «Caractère sexuel»… Si on cherche a caractère dans le dico on trouve: «Caractères sexuels; caractères qui différencient les sexes». Mais c’est la définition biologique. Et si on cherche sexualité on trouve: «Ensemble des pulsions et des actes qui, dès la première enfance, tendent à obtenir des satisfactions sensuelles (autres que celles des besoins d’autoconservation) en débordant la simple génialité et en investissant toutes les zones érogènes.» Donc le caractère sexuel de l’architecture ce serait l’expression architecturale des pulsions et des actes tendent à obtenir des satisfactions sensuelles (autres que celles des besoins d’autoconservation) en débordant la simple génialité et en investissant toutes les zones érogènes. Ou bien ce qui dans l’architecture permet aux individus d’obtenir des satisfactions sexuelles…
Après quelques blagues sur les obélisques, les pyramides et les Ziggourat… On peu se poser la question de savoir si il s’agit de l’architecture dans sa vision exhibitionniste (vu de l’extérieur) ou intimiste (le premier caractère sexuel de l’architecture étant alors en protégeant l’activité sexuelle du contrôle social, permettant ainsi son expression débridée). Cacher ou montrer.
Miguel Decleire — 23:25
Nous voilà repartis pour un tour. Autre thème, autre invité. Déjà on peut se dire que les semaines se suivront et ne se ressembleront pas.
La réflexion avance bien, assez concrètement.
Il y a plusieurs pistes, mais la principale tient à pourquoi Freud n’a pas écrit l’essai en question. Sans doute qu’il avait trop rêvé sur Rome et l’antiquité pour ne pas être déçu quand il l’a vue en réalité. Ce qui m’amuse à ce stade-ci, ce sont les différents niveaux de fantasmes dans lesquels nous sommes pris. Freud a rêvé l’antiquité, et lorsqu’il est en Grèce, il pense faire un essai sur le caractère sexuel de l’architecture. Lhoas et Lhoas, un siècle plus tard, sont interpellés par cette réflexion qui n’aboutit pas, sans doute qu’elle fait écho à leurs préoccupations sur l’architecture, et que ça les intéresse de l’inscrire dans une perspective historique. Ils nous refilent cette patate chaude à nous qui sommes des des concepteurs d’espace de séduction que nous nous aménageons sur mesure dans des volumes déjà «architecturés».
Pour le moment, avec Joseph Falzon, nous envisageons un rêve d’architecture, en 2 dimensions. Une sorte de maquette plate, avec des plans qui se superposent de loin en loin. Peut-être avec des surprises, une première couche apparente, et une seconde qui se révèlerait quand on change de point de vue. Joseph nous dit que l’enjeu, dans la bande dessinée, pour lui, c’est comment créer du temps dans l’espace des cases. C’est le lecteur qui est le maitre du rythme, et la difficulté pour le dessinateur est de lui donner des indications précises. Cette autre façon de travailler le temps me donne envie de rendre le spectateur responsable de son parcours, de son rythme, dans une narration qui se ferait par le mouvement du spectateur dans l’espace, et pas celui de l’acteur. Un autre rapport de l’espace et du temps que celui qu’on expérimente d’habitude au théâtre.
Nous n’avons pas encore le livre dont est extrait le «sujet», nous ne l’aurons que demain. Si tout va bien. Il est difficile à trouver. Peut-être que les lettres de Freud seront plus explicites sur les raisons qui lui ont donné envie d’écrire, et puis la lui ont coupée.
Bernard Van Breusegem — 23:25
Disons que je le savais. Ce matin, sur mon vélo, en me rendant au studio de la rue Gray, je pédalais assez machinalement et ma pensée ronronnait comme la chaîne de mon véhicule. Je pensais encore au sujet de la semaine dernière, à cette linéarité du langage, et pas nécessairement du sens, au temps qui se déroule, tout en me demandant, assez naturellement sur mon cycle, si le temps ne l’était pas lui aussi, cyclique. Quand tout à coup, tandis que je fixais le feu, attendant qu’il passe au vert, l’image de Joseph Falzon s’est imposée à moi. Et je me suis dit: «tiens, cette semaine, ça va être lui, forcément». Et en arrivant au studio, c’était lui, naturellement, et j’ai envie de dire, calmement. Il serait un peu présomptueux de dire qu’on peut connaître quelqu’un en un jour, mais on peut, un peu, se rendre compte de l’effet qu’il produit sur nous et de ce qui en résulte. Alors aujourd’hui, simplement un grand calme. Le plaisir d’être là ensemble, je pense, de se découvrir mutuellement, et en plus, cette impression bizarre mais pas désagréable du tout: nous retrouvons la salle telle une page blanche, comme si rien ne s’y était passé, avec juste un petit fumet dans l’air, comme au-dessus d’une table qui a accueilli un bon repas et qui vient d’être débarrassée. Et pour ce qui est du menu de la semaine, l’architecture a donc fait aujourd’hui son entrée, en nous servant à sa suite Sigismund Freud a la romana (mais pas seulement), dans un mélange, qui pourrait peut-être s’avérer aphrodisiaque. Je suis un peu cryptique, mais pas tellement si vous avez lu le sujet ; ce qui est excitant (!), c’est qu’il entraîne à sa suite tout un cortège d’envies, de désirs, de rêves, et d’interprétations de ceux-ci. Et après tout, c’est aussi ce qui nous est demandé: interpréter, sur scène ou non, quelque chose qui tarabuste ceux qui nous le confient.

.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
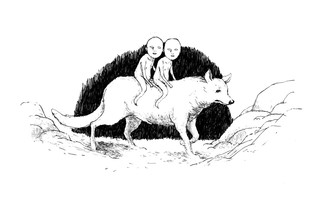
.gif)
D S de G — 17/10 22:47
J'ai vu quelques images webcam d'une fin de répétition Blind date... C'est très étrange cette possibilité d'assister par un coin de rideau- silencieux- à votre mise en oeuvre... Le spectacle commence aussi par ce lien et lieu possible, celui du regard anonyme sur ce qui est donné à voir (et non à entendre - si ce n'est par vos billets, décalés donc des images temporellement) et qui a un effet inévitablement réflexif, méditatif. Cette caméra web fixe (et bel et bien choisie par vous) m'a fait me projeter dans une forme de calme ressenti dans les films d'Ozu. J'imagine que ces images pourraient faire partie d'une construction étrange : l'architecture imaginaire du spectateur : celle qu'il imagine et construit dans sa pensée à la vue de ces bouts d'images et de papiers...